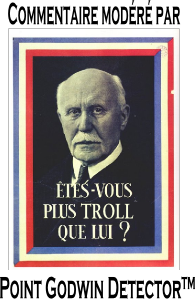Le
tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 6 août
dernier qui a fait couler beaucoup de pixels sur l’internet, avec
je le crains quelques approximations et incompréhension.
Il
faut dire qu’il a de quoi provoquer une certaine émotion : ce
jugement impose à tous les Fournisseurs d’Accès Internet (ou
presque, en tout cas les principaux) d’empêcher par tout moyen
l’accès à un site internet. Revoici le spectre de la censure avec
la Justice comme son bras armé.
Voyons
donc ensemble ce que dit ce jugement, à vous de voir ensuite s’il
y a de quoi sonner le tocsin.
Tout d’abord, la distribution des rôles
Dans
tout procès, il y a un demandeur, et un défendeur.
Le
demandeur, ici, est le président de l’Autorité
de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL), une autorité
administrative indépendante (une de plus…) créée par la loi
n°2010-476 du 12 mai 2010 sur les jeux en ligne, loi dont la
présente décision est, comme vous le verrez, une application pure
et simple. C’est le président de cette autorité qui est le
demandeur, puisque l’ARJEL n’a pas la personnalité morale, comme
c’est fréquemment le cas pour les autorités administratives
indépendantes. Son président la représente donc, comme un tuteur
représente son pupille, ce qui déjà en dit long sur l’indépendance
de cette autorité.
Le
défendeur est en fait une brochette de défendeurs. Il y a une
société de droit anglais, NEUSTAR,
présentée comme hébergeur de sites, les
sociétés françaises Numéricable, Orange France, SFR, Free,
Bouygues Telecom, Darty Telecom, Auchan Telecom, auquel vient
s’ajouter France Telecom comme intervenant volontaire (c’est-à-dire
que bien que non assignée comme défendeur, cette société s’estime
concernée par le débat et demande à y participer). Et comme plus
on est de fou, plus on rit, le parquet de Paris va lui aussi
s’inviter aux débats, comme il en a la faculté pour toutes les
affaires jugées devant le tribunal. On dit qu’il est partie
jointe, et joue dans ce cas un rôle très proche du rapporteur
public devant la juridiction administrative, l’indépendance en
moins. En l’occurrence, comme il s’agit de la première
application d’une loi nouvelle mettant en cause la liberté de
communication, on comprend qu’il ait voulu avoir son mot à dire.
Ce
qui peut paraître curieux de prime abord, c’est que le principal
intéressé par ce procès, la société de droit anglais Stan
Gibraltar Limited (l’équivalent d’une SARL), n’est pas partie
au procès, alors que vous allez voir qu’il ne sera pour ainsi dire
question que d’elle. C’est que le législateur a eu l’idée
d’une bien étrange procédure.
Ensuite, la forme de la procédure
C’est
là la source d’une confusion que quasiment tout le monde a fait
dans les commentaires que j’ai pu lire, et pour votre défense,
sachez que nombre d’élèves avocats la font encore, et que même
ce jugement l’a fait, en s’intitulant “ordonnance”. Il ne s’agit pas d’une ordonnance de
référé, mais bien d’un jugement, qui a été rendu « en
la forme des référés ». C’est peut-être un détail
pour vous, mais pour un juriste ça veut dire beaucoup.
Une
ordonnance de référé est rendue à juge unique après une audience
unique dont la date est fixée dès l’assignation, et vise à
ordonner des mesures par nature provisoires, essentiellement
justifiées par l’urgence et l’évidence. Mettre fin à un
trouble illicite, désigner un expert, accorder une provision sur une
somme d’argent en attente d’être fixée, etc.
Une ordonnance de
référé n’est pas couverte par l’autorité de la chose jugée
qui interdit de remettre en cause un jugement définitif, c’est à
dire qui n’est plus susceptible de recours. Une ordonnance de
référé peut toujours être remise en cause, en cas de fait nouveau
ou de modification des circonstances : il suffit d’assigner son
adversaire devant le même juge des référés (pas la même
personne, juge s’entend de la fonction) et demander que
l’ordonnance initiale soit modifiée ou annulée (on dit
rapportée).
Un
jugement rendu en la forme des référés
comme celui qui nous occupe est bien un jugement au fond. Le juge
ayant statué ne peut revenir sur sa décision. Celle-ci a vocation à
acquérir l’autorité de la chose jugée, sauf si elle est réformée
en appel. Simplement, la procédure qui lui est applicable est celles
des référés : juge unique, pas de représentation obligatoire par avocat, une
audience unique (en principe) dont la date est fixée dès le stade
de l’assignation. La procédure ordinaire, elle, suppose que chaque
partie ait un avocat (on dit constituer
avocat), et n’a pas de date fixée à l’avance. L’assignation
informe simplement le défendeur qu’un procès lui est intenté
devant le tribunal de telle ville, à charge pour elle de constituer
avocat. La date de jugement ne sera fixée qu’au terme d’une
procédure préalable de mise en état,
comprendre mise de l’affaire en état d’être jugée, où un juge
(le juge de la mise en état) va s’assurer que toutes les diligences sont accomplies et va régler
seul les questions de pure procédure, de sorte que l’affaire
viendra devant la juridiction collégiale prête à être jugée,
sans qu’aucune mauvaise surprise ne puisse en principe s’y
opposer.
Prévoir
qu’une affaire est jugée en la forme des référés est une
possibilité offerte au législateur pour les affaires les plus
simples, où l’office du juge se borne à vérifier que les
conditions d’application de la loi sont remplies, ses effets étant
parfaitement prévisibles et bornés par la loi. C’est le domaine
des actions en exequatur,
qui consistent à donner force exécutoire à un jugement étranger.
Une convention bilatérale entre la France et le pays concerné peut
prévoir que cet exequatur
se donne en la forme des référés, quand la Convention prévoit que
le juge se borne à vérifier que les parties ont bien été
convoquées, que le juge étranger était compétent, et que le
jugement a bien été notifié aux parties, et bien sûr que ce
jugement ne viole pas l’ordre public français (pas d’exequatur
d’une répudiation, par exemple).
Et
c’est précisément ce cadeau qu’a fait le législateur à
l’ARJEL en lui permettant d’agir en la forme des référés pour
faire empêcher l’accès à un site de jeu en ligne non agréé.
L’article
61 de la loi du 12 mai 2010
Avant
de nous attarder à cet article 61, qui est le cœur de cette
décision, rappelons brièvement que la loi du 12 mai 2010 réglemente
le secteur des jeux en ligne, en réservant cette activité aux
seules sociétés préalablement agréées par l’ARJEL. Cet
agrément vise moins à protéger le consommateur que l’État, en
lui assurant que les revenus générés par cette activité
n’échapperont pas au fisc. La protection des joueurs se résumera
à une phrase écrite en caractères illisibles sur les publicités
invitant les joueurs irresponsables à se prendre en main, et dont on
peut attendre la même efficacité que les phrases préventives
contre l’alcoolisme, le tabagisme et le surpoids. Mais c’est une
façon de se payer une bonne conscience à peu de frais, ce qui est
une des activités préférées du législateur.
Afin
de faire respecter ce monopole, la loi a donné à l’ARJEL un
pouvoir assez particulier, qui se situe à l’article 61 de la loi.
C’est ce pouvoir qui est utilisé pour la première fois dans cette
affaire, et c’est ce qui lui donne tout son intérêt.
L’article
61 donne en effet pouvoir à l’ARJEL — enfin, son président—
de demander en justice toute mesure permettant de faire obstacle à
l’accès effectif à un site de jeu en ligne non agréé par elle.
Cette
procédure suppose un préalable : l’ARJEL doit mettre en demeure
l’opérateur du site non agréé de cesser d’offrir ses activités
vers la France en lui expliquant comment se mettre en conformité, et
ce sous huit jours, délai pendant lequel il peut présenter ses
observations. Je précise que la loi n’impose nullement l’usage
d’une autre langue que le Français pour cette notification, qui
par définition s’adresse à des sociétés étrangères. Ça leur
apprendra à parler étranger, à ces étrangers (et en plus pas tous
le même étranger !).
Si
au bout de 8 jours, le service n’a pas cessé, le président de
l’ARJEL peut saisir le président du tribunal de grande instance de
Paris, qui a seul compétence, pour voir ordonner « l’arrêt
de l’accès à ces services », sans autre précision, aux
personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique. Vous reconnaîtrez là le goût du
législateur pour la simplicité et la lisibilité de ses lois, qui
sont incompréhensibles sans un accès à l’intégralité de son
œuvre.
Les
“personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique” sont, en français courant,
respectivement, les hébergeurs et les FAI.
Vous
voyez donc toute la bizarrerie de la procédure : l’opérateur
étranger est en faute, donc on fait un procès aux hébergeurs et
FAI, que la LCEN précitée rendait précisément irresponsables du
contenu des sites auxquels ils donnaient accès. Procès auquel
l’opérateur étranger n’est pas partie. La logique est simple et
efficace : on prend ceux qu’on a sous la main.
Mais
cette situation ne devant pas nuire à des tiers qui n’ont commis
aucune faute (les FAI), le même article 61 prévoit dans son dernier
alinéa que ceux-ci seraient indemnisés du coût engendrés pour eux par ces blocages, selon des modalités prévues par un décret.
Décret
qui, vous l’avez deviné, n’a pas été pris. Et qui, vous allez
le voir, risque fort de ne jamais l’être, après cette décision.
Bon,
si vous avez suivi jusqu’ici, vous connaissez la procédure, vous
connaissez le droit applicable, bref, la suite va vous apparaître
d’une clarté diaphane.
Moteur, action !
Tout
commence avec une société anglaise située à Gibraltar, Stan
Gibraltar Ltd, qui exploite le site de jeux en ligne Stanjames.com.
Ce site est accessible depuis la France, existe en version française,
et il n’a pas l’agrément de l’ARJEL.
Le
24 juin 2010, un huissier mandaté par l’ARJEL se connecte à
Stanjames.com et place un pari (le jugement ne dit pas si c’était
sur Slovaquie - Italie ou Paraguay – Nouvelle-Zélande). Cela
caractérise l’infraction à la loi du 12 mai 2010.
Le
25 juin 2010, l’ARJEL va adresser à la société Stan Gibraltar
une lettre via courrier électronique via la page de contact en
français du site plus par télécopie plus par courrier FedEx
acheminé le 25 et livré le 30 juin (5 jours pour un Paris-Gibraltar
en FedEx ??), la mettant en demeure de cesser de proposer ses
services vers la France, faute pour elle d’être en conformité
avec la loi française.
Face
à ce spam, Stan Gibraltar ne va rien faire, puisque le 5 juillet, le
même huissier va placer un nouveau pari accepté sur le site
Stanjames.com (le jugement ne dit pas si l’huissier a gagné ou
non).
Le
7 juillet, le président de l’ARJEL fait donc assigner les FAI
précités ainsi que la société Neustar en tant qu’hébergeur du
site Stanjames pour voir condamner tout ce petit monde à empêcher
par tout moyen l’accès au site Stanjames.com depuis la France. Il
demande en outre que la société Neustar soit condamnée aux frais
de l’instance, évalués à 5000 euros. J’avoue que les raisons
de cette condamnation m’échappent, l’hébergeur n’étant pas
responsable du contenu illicite d’un site.
Hélas,
cette question n’aura pas de réponse, puisque la société Neustar
n’a pas comparu, et l’ARJEL n’a pu prouver que son assignation
l’avait effectivement atteinte (cette question a fait l’objet
d’un renvoi à une audience du 2 septembre prochain), et en tout
état de cause ne devrait pas recevoir de réponse puisqu’il
semblerait, à en croire le site Numerama,
que la société Neustar ne soit que le registrar
du nom de domaine Stanjames.com, et non l’hébergeur, le site étant
hébergé sur un serveur propriété de la société Stan Gibraltar
Ltd. L’erreur, si elle était avérée, serait du fait de l’ARJEL, et aboutirait nécessairement à la mise hors de cause de Neustar, l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 ne permettant pas (encore) la mise en cause des bureauxw d’enregistrement de nomùs de domaine (registrar)
Restent
donc face à face le président de l’ARJEL d’un côté, le front
des FAI de l’autre.
Voyons
les arguments soulevés.
En joue ! Feu !
La
société Darty va d’abord essayer de se carapater en arguant être
fournisseur d’accès à des « services » et non à des
réseaux dont elle n’est pas propriétaire et ne pas être
concernée. Le président va rapidement écarter l’argument : cette
distinction fournisseur d’accès à des services / des réseaux
n’existe pas juridiquement. On est fournisseur d’accès à
internet, point.
Les
FAI vont ensuite soulever une série d’arguments plutôt
intéressants.
► Le
premier argument était que le dispositif de l’article 61 n’était
pas entré en vigueur faute pour le décret prévu par le 3e alinéa,
prévoyant les modalités de l’indemnisation des FAI, d’avoir été
pris.
L’argument
était pertinent. Le législateur a fait peser sur des tiers la
charge du blocage de l’accès aux sites non agréés, quand bien
même ils ne sont ni fautifs ni même responsables, à charge pour
lui de les indemniser du coût de cette nouvelle obligation qui
relève du fait du Prince. On pouvait arguer comme l’ont fait les
FAI que ce système forme un tout, et qu’il ne peut fonctionner
sans le volet d’indemnisation, donc que son entrée en vigueur
dépendait de la promulgation de ce décret.
Le
juge ne va pas suivre cet argument. Il va estimer que les deux
premiers alinéas se suffisent à eux même, le volet
« indemnisation » étant un simple plus pour les FAI, qui
sont d’ores et déjà tenus à leurs obligations légales
nouvelles. Sans contrepartie.
Vous
comprenez donc pourquoi ce décret risque de traîner, traîner,
traîner, voire ne jamais être pris, puisque l’État jouit de
cette obligation gratuitement pour le moment.
Rien
que pour cela, les FAI ont tout intérêt à faire appel, pour
espérer obtenir une autre interprétation de la Cour d’appel. Car
si elle décidait qu’au contraire, les FAI n’étaient tenus à
rien tant que le décret d’indemnisation n’était pas pris, on
verrait l’État se réveiller et prendre ce décret avec une
célérité rare, semblable à celle qui l’a pris quand il a fallu
prendre les décrets d’applications indispensables à l’entrée
en vigueur de cette loi avant la coupe du monde de football (loi
promulguée le 12 mai, les trois
premiers
décrets
d’application ont été signés le même jour, et en tout pas moins
de neuf
décrets
d’application
ont été signés
dans la semaine
qui a suivi
la promulgation, cinq
autres
moins
urgents
ayant
suivi par la suite). Dans cette frénésie de décrets, celui fixant
l’indemnisation des FAI a mystérieusement été oublié… Pas de
bol, hein ?
Deuxième
argument soulevé de conserve par les FAI : cette curieuse procédure
de l’article 61, qui vise tout le monde sauf le principal
intéressé, est contraire à l’article 6 de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
(CSDH) qui prévoit le droit à un procès équitable. En effet, la
procédure vise à frapper la société Stan Gibraltar Ltd qui n’a
pas été mise en cause (au sens juridique : mis dans la cause, c’est
à dire rendue partie au procès) puisqu’elle n’a même pas été
assignée et n’est pas au courant de ce qui se trame pour rendre
inaccessible son site depuis la France. La moindre des choses serait
de lui permettre de se défendre.
Bon,
ne soyons pas dupes. Les FAI, en défendant les droits fondamentaux
de Stan Gibraltar Ltd, n’ont pas les droits de l’homme comme
préoccupation. Mais si Stan Gibraltar Ltd était partie au procès,
il suffirait de la condamner à rendre son site inaccessible depuis
la France, sans que les FAI aient à faire quoi que ce soit, et
surtout se prennent un procès chaque fois que l’ARJEL voudra
empêcher l’accès à un site non agréé alors qu’ils n’y sont
pour rien.
Le
juge va aussi écarter cet argument en estimant que la société Stan
Gibraltar, en tant que société d’un État membre de l’UE, peut
solliciter de l’ARJEL l’agrément prévu par la loi du 12 mai
2010, et qu’un éventuel refus peut être contesté devant le juge
administratif, ce qui préserve le droit de cette société à un
procès équitable. Il en déduit que la procédure de l’article
61 de la loi, qui ne la met pas en cause, est conforme à l’article 6 de la CSDH.
C’est
peut-être un peu court. Car il demeure qu’hormis l’invitation à
présenter ses observations sous huit jours faite lors de la mise en
demeure par l’ARJEL, dans une langue qui n’est pas celle de
l’intéressé, pour justifier en quoi son activité, au demeurant
légale dans le pays où elle est installée, est conforme à une loi
française que cet opérateur n’est pas censé connaître puisque
ne résidant pas en France, la société Stan Gibraltar n’est pas
mise en mesure de présenter sa défense dans le procès qui va
conduire à rendre son site inaccessible depuis la France, avec comme
conséquence d’engager sa responsabilité civile à l’égard de
ses clients ayant placé des paris sur son site avant cette mise à l’Index. Relisez cette
phrase à voix haute, je sais qu’elle est longue.
Je
ne suis pas sûr que la Cour
Européenne des Droits de l’Homme verra cette
procédure avec les yeux de Chimène qu’a eus le président du
tribunal de grande instance de Paris.
Ces
deux arguments visant à faire échec à l’application de la loi
ayant été écartés, il ne reste au juge qu’à fixer les
obligations des FAI. Et il va faire le choix du a maxima.
Tout
d’abord, il va estimer que le fait que l’hébergeur supposé, la
société Neustar, n’ait pas valablement été cité à
comparaître est indifférent. Simplement, le juge ne prononcera
aucune condamnation à son égard, repoussant cela à une nouvelle
audience le 2 septembre pour permettre à l’ARJEL de prouver
que cette société anglaise a reçu sa citation en justice.
Pour
les FAI, c’est simple. Ils ont une obligation de résultat, donc
doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, telles que
« blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de
l’URL, ou par analyse du contenu des messages, au besoin
cumulativement ». Le tout à leurs frais, faute de décret
d’indemnisation, et ce dans un délai de deux mois, sous astreinte
de 10 000 euros par jour de retard au-delà, avec exécution
provisoire, c’est-à-dire qu’un éventuel appel ne sera pas
suspensif.
Tout
au plus le président rejette-t-il la demande de publication du
jugement demandée par le président de l’ARJEL (mais je le fais
gracieusement au pied de ce billet, qu’il ne me remercie pas),
puisque cette mesure n’est pas prévue par l’article 61 et ne
s’impose nullement.
Conclusion provisoire
Nous
avons donc bel et bien un jugement au fond,
j’insiste là dessus qui condamne les principaux FAI à empêcher
l’accès à un site, par tout moyen, sur le mode du
« demmerdez-vous, c’est à vos frais ».
C’est
regrettable en soi, et le fait qu’une telle mesure n’est, à ce
jour, susceptible de concerner que des sites de jeu en ligne n’est
pas à mon sens de nature à rendre la chose insignifiante sous
prétexte que je ne joue pas aux jeux d’argent.
Car cela révèle
que l’État, pour parvenir à ses fins (ici protéger un marché
réglementé, et on ose appeler ça la libéralisation du secteur
des jeux en ligne !) est prêt à inventer des procédures
abracadabrantesques, où l’on fait un procès à tout le monde sauf
au principal intéressé parce que ce serait trop compliqué à faire
exécuter, que les juges appliquent sans tiquer malgré des
objections très sérieuses (celle de l’indemnisation n’étant
pas la moindre, car aujourd’hui, il n’y a guère que l’argent
qui arrête l’État).
Comment l’en blâmer, puisque ça marche.
Au-delà des intérêts de Stanjames.com, dont je n’ai que faire,
n’étant pas son avocat, il y a là pour la première fois la
tentative de créer un internet franco-français, d’établir une
frontière numérique autour de la France, en s’attaquant au goulot
d’étranglement : les fournisseurs d’accès internet, passages
obligés et en nombre limités.
La
possibilité d’abus est considérable, et je ne suis pas sûr que
les contre-pouvoirs existent pour les prévenir.