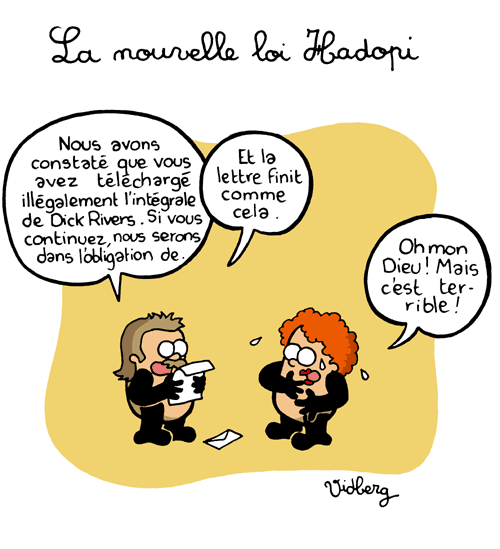La loi HADOPI est donc allée devant le Conseil Constitutionnel comme César est allé aux Ides de Mars : pour y rencontrer sa fin.
Un rapide rappel de ce qu'est le Conseil constitutionnel pour mes lecteurs étrangers, car pour tout citoyen français, il va de soi que les articles 56 et suivants de la Constitution n'ont aucun secret.
Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution, la norme suprême, supérieure aux lois et aux traités, même européens[1]. La Constitution est une loi adoptée dans des conditions très particulières qui rendent sa modification extrêmement difficile et qui fixe les grands principes de la République (la Constitution inclut ainsi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pose le principe de l'égalité sans distinction d'origine, de race ou de religion, etc…) et de son fonctionnement (c'est la Constitution qui établit le drapeau, l'hymne national, ainsi que les pouvoirs du président de la République, du Gouvernement, du Parlement, etc…).
Quand une loi est adoptée, elle peut (c'est facultatif, sauf trois exceptions : les lois soumises à référendum, les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires) être déférée au Conseil constitutionnel qui jugera de leur conformité à la Constitution. La décision de déférer une loi au Conseil constitutionnel peut être prise par le président de la République, le président du Sénat, le Président de l'assemblée nationale, ou un groupe de soixante députés ou soixante sénateurs (pas de panachage entre les deux assemblées). Cette décision, appelée recours, doit idéalement être motivée, c'est-à-dire indiquer en quoi cette loi violerait la Constitution. La qualité des recours est très variable, et je ne sais pas ce qu'attendent les groupes parlementaires pour se constituer une équipe d'avocats constitutionnalistes. Ils en ont les moyens et ce serait redoutablement efficace.
Survolons rapidement les arguments rejetés par le Conseil avant de nous attarder sur ceux qu'il a retenus, soit en formulant une réserve d'interprétation, soit en annulant purement et simplement.
(NB : les numéro après le symbole § renvoient aux numéros de paragraphe de la décision).
Les moyens rejetés.
► La procédure d'adoption de la loi : les parlementaires auteurs de la saisine affirmaient ne pas avoir reçu les informations suffisantes du gouvernement pour pouvoir légiférer en connaissance de cause. La Conseil estime que les assemblées ont disposé, comme l'attestent tant les rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte rendu des débats, d'éléments d'information suffisants (§3).
► L'obligation de surveillance de l'accès à internet : les requérants soutenaient que l'obligation faite aux abonnés à l'internet par l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle (créé par la loi HADOPI) de veiller à ce que cet accès ne serve pas à pirater[2] ferait double emploi avec le délit de contrefaçon et serait formulée de façon trop générale, alors que la Constitution exige que la loi soit claire et accessible. Le Conseil rejette, estimant au contraire que la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de contrefaçon ; qu'elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et précis (§7). Je suis d'accord.
► Le renvoi à des décrets en Conseil d'État : les requérants critiquaient le renvoi à des décrets pour définir les modalités de délivrance du label HADOPi certifiant qu'une source de téléchargement est légale. Le Conseil rejette en rappelant qu'il s'agit d'une simple information du public et que l'HADOPI n'aura pas le choix et devra délivrer ce label à tout site en faisant la demande qui remplit les conditions légales. Dès lors, le législateur a bien rempli son rôle, le reste n'étant que de l'intendance, domaine du décret (§35).
Les réserves d'interprétation.
Une réserve d'interprétation est une façon inventée par le Conseil de corriger une inconstitutionnalité sans dégainer l'arme nucléaire de l'annulation. Le Conseil dit que si on applique le texte de telle façon, alors il n'est pas contraire à la Constitution. Ces réserves d'interprétation sont prises en compte par les juges, qu'ils soient administratifs ou judiciaires.
On commence à entrer dans les aspects intéressants de la décision. La loi HADOPI n'est pas, sur ces points, censurée, mais elle est modifiée dans son esprit.
► L'atteinte à la vie privée : Attention, c'est un peu subtil.
Les données relatives aux infractions de piratage sont relevées par des agents assermentés qui sont salariés des sociétés de gestion collective de droits d'auteur (essentiellement pour transférer le coût des ces opérations sur ces sociétés plutôt que les faire supporter par l'État). Ces données sont collectées dans un fichier informatisé géré par ces sociétés privées. Jusqu'à présent, ces données étaient soit communiquées au parquet au soutien d'une plainte, soit directement utilisées par ces sociétés pour poursuivre les internautes concernés en justice. Dans tous les cas, c'était l'autorité judiciaire qui ordonnait au fournisseur d'accès internet (FAI) la communication de l'identité du titulaire de l'abonnement suspect[3]. Avec la loi HADOPI, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADŒPI) qu'elle crée acquiert le droit de se faire communiquer directement et sur simple demande par le fournisseur d'accès internet concerné, les coordonnées du titulaire de l'abonnement, pour mettre en jeu sa responsabilité. L'autorité judiciaire est court-circuitée. C'est cela que contestaient les requérants devant le Conseil constitutionnel : il y a une atteinte disproportionnée au droit des citoyens au respect de leur vie privée en permettant à une autorité administrative de se faire communiquer ces données personnelles sur simple demande.
Le Conseil donne raison aux requérants, mais sans aller jusqu'à interdire ce dispositif. Il précise que la loi HADOPI permettant l'identification des titulaires des abonnements correspondants aux adresses IP collectées par les agents assermentés a pour effet de rendre ces données nominatives, ce qu'elles n'étaient pas auparavant. Le Conseil rappelle donc que la Commission Nationale Informatique et Liberté (la CNIL) a pour vocation de surveiller les traitements informatiques de données nominatives, et qu'il lui appartiendra de s'assurer que les modalités de ce traitement sont proportionnées au but poursuivi. En clair, cela signifie que toute poursuite fondée sur ces relevés sera nulle tant que la CNIL n'aura pas donné son feu vert quant au fonctionnement de ce fichier (§29). Où comment la rue Montpensier venge la rue Vivienne. La CNIL est notamment invitée à veiller à ce que ces données ne servent que dans le cadre des procédures judiciaires liées au piratage supposé et ne soient pas conservées à d'autres fins, genre une liste noire des pirates.
► Les mesures judiciaires envers les FAI : l'article 10 de la loi ajoute au code de la propriété intellectuelle un article L. 336-2 qui permet aux ayant-droits d'une œuvre objet de piratage d'obtenir du tribunal de grande instance, au besoin en référé, toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte à leurs droits, auprès, là est la précision importante, « des personnes susceptibles de contribuer à y remédier », et non uniquement auprès des personnes auteurs de cette atteinte. Quelle périphrase, mes amis, pour dire simplement fournisseur d'accès internet et hébergeurs ! En clair, la loi permet aux ayant-droits d'une œuvre piratée d'obtenir du FAI qu'il puisse suspendre l'accès internet du pirate supposé, et de l'hébergeur qu'il supprime de son serveur le fichier ou le site illicite (mais sur ce dernier point, la loi n'invente rien, le droit commun le permet déjà). Suspension, il y a, mais ordonnée par l'autorité judiciaire, ce qui est une garantie. Insuffisante, estime le Conseil, qui souffle à l'oreille du juge le mode d'emploi : il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté [la liberté d'expression, voir plus bas], que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause (§38). Bref, le juge devra se contenter d'ordonner le minimum minimorum pour mettre fin à cette atteinte au droit d'auteur sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, qui devient la marraine, comme on va le voir, de l'accès à internet. Autant dire que le seul abonnement qui pourra être suspendu est celui qui ne sert qu'à pirater à l'exclusion de tout blogging, twitting, facebooking, netsurfing et autres mot en -ing visant à précipiter les Académiciens vers une mort prématurée par apopléxie.
Le Conseil a posé ses banderilles. Vient le moment tant attendu de l'estocade. Cette fois, le Conseil frappe pour tuer.
Les annulations.
Les annulations portent sur toutes sur le même point : la répression des manquements à l'obligation de surveillance.
Rappelons d'une phrase le mécanisme de la loi HADOPI : tout abonné à internet a l'obligation de veiller à ce que son abonnement ne serve pas à pirater, peu importe qui pirate ; tout piratage constaté depuis un abonnement donné est une violation de cette obligation par le titulaire de cet abonnement, qui peut être sanctionné, après deux avertissements, par une suspension de l'abonnement décidée par une autorité administrative, la Commission de Protection des Droits (et non la HADŒPI), hors de toute procédure judiciaire.
Et c'est là que le bât blesse pour le Conseil constitutionnel. Au cours des débats, on a beaucoup entendu dire et répéter que, que diable, il n'y a pas de droit à l'abonnement à internet, et qu'internet n'est pas un droit fondamental[4]. Le Conseil disconvient respectueusement (§12) :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ;
Internet ne devient pas une liberté fondamentale, mais le voici le pupille de la liberté d'expression, ce qui le met sur un beau piédestal.
Mais le Conseil constitutionnel apporte aussitôt un tempérament (§13), en rappelant qu'on est ici dans un conflit entre deux droits fondamentaux : la liberté d'expression, dont internet est le prophète, et la propriété, dont le droit d'auteur est une variante immatérielle mais tout aussi protégée.
Face à ce conflit, le législateur a un certain pouvoir d'appréciation :
Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines[5] ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle (§14).
Là, on retient son souffle. HADOPI est-elle sauvée ? Une incise pendant que vous virez lentement au rouge puis au bleu : ce genre de conflits entre des principes d'égale valeur mais contradictoires est le cœur de ce qu'est le droit. C'est l'essence du travail du juriste que de résoudre ce conflit, non pas en disant lequel des deux l'emporte, mais en délimitant le territoire de chacun selon les hypothèses. Dans tels et tels cas, le premier l'emportera, mais avec ces limites ; dans telles autres, ce sera le second, mais là encore dans telles limites pour préserver le premier. Exemple typique : le juge pénal, qui doit concilier la nécessité de la répression d'un comportement interdit avec celle de réinsérer l'individu qui a commis ces faits. Punir le passé en tenant compte du présent sans insulter l'avenir. On n'est pas trop de trois (le juge, le procureur et l'avocat) pour y arriver.
Allez-y, vous pouvez respirer : ici, c'est la liberté d'expression qui l'emporte, et le couperet tombe aussitôt sur la loi.
Le Conseil rappelle d'abord que « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » ; et « que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (§15). Tous ceux qui ont lu la loi savent déjà que c'en est fini de son mécanisme répressif. Pour les autres, le Conseil continue :
les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction[6], à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;
En clair : la liberté d'expression ne s'efface pas pour protéger des intérêts économiques catégoriels aussi nobles soient-ils (rires).
Le coup est mortel mais alors que la bête titube encore, le Conseil porte une seconde estocade : la loi HADOPI piétine également la présomption d'innocence.
En effet, la loi HADOPI met en cause la responsabilité de l'abonné par la simple constatation du piratage, qui suffit à mettre en branle la machine à débrancher, sauf à ce que l'abonné démontre que le piratage est dû à la fraude d'un tiers (je laisse de côté la force majeure, qui exonère de toute responsabilité sans qu'il soit besoin de le prévoir dans la loi, et l'installation du logiciel mouchard, qui au contraire interdit de facto à l'abonné d'invoquer la fraude d'un tiers). Preuve impossible à rapporter.Ce renversement de la charge de la preuve aboutit à faire de l'abonné mis en cause un coupable jusqu'à ce qu'il prouve son innocence(§18). C'est prévu par le code pénal nord coréen, mais pas par le nôtre. Le législateur a imaginé ce mécanisme anticonstitutionnellement[7]
La bête s'écroule et le Conseil prélève les deux oreilles et la queue : toutes les dispositions donnant un pouvoir de sanction à la Commission de Protection des Droits sont annulées.
Conclusion : la loi HADOPI est-elle morte ?
Elle est en coma dépassé : son corps vit encore mais son esprit a basculé dans le néant. Le reste de la loi étant validé, le président de la République a quinze jours pour la promulguer, ou demander au parlement une seconde délibération (art. 10 de la Constitution). La HADŒPI sera créée (mon petit doigt me dit qu'elle va fusionner avec l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques créée par DADVSI), ainsi que la CPD. La HADŒPI se contentera donc de délivrer son label “ ici, on télécharge légalement, lol ” à qui en fera la demande, et remplira ses autres missions, purement consultatives.
Le Conseil constitutionnel tire d'ailleurs les conclusions de son annulation et de l'absence de jugeotte du parlement en donnant le mode d'emploi qui ne manque pas d'ironie (§28) :
…à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;
Traduction : la CPD existera bel et bien mais sera cantonnée à un travail d'avertissement sans frais (les mises en garde par courrier existent toujours, tout comme l'obligation de surveillance de sa ligne, mais elles ne peuvent aboutir à des sanctions), de filtrage et de préparation des dossiers pour l'autorité judiciaire, dans le but, et c'est là qu'on voit que le Conseil constitutionnel a le sens de l'humour, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie.
Bref la machine à punir 10.000 pirates par jour devient la machine à s'assurer qu'on ne poursuive pas trop de pirates, emporté par l'enthousiasme au mépris de la charge de travail des tribunaux au budget insuffisant.
On n'avait pas vu un tel succès législatif depuis la promulgation-abrogation du Contrat Première Embauche en 2006.
Voir aussi l'avis de Jules, toujours le plus rapide s'il n'a pas un verre de Chardonnay dans une main et la taille d'une jolie fille dans l'autre.