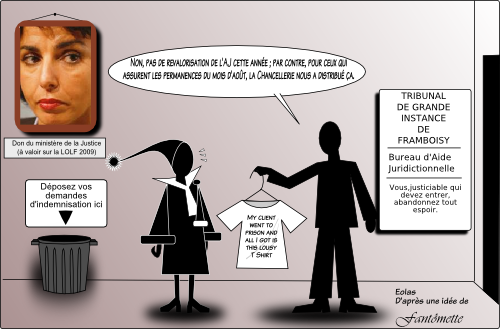« Ah, ça, mon ami, vous me voyez toute contrariée !
— Vous, ma mie ? Cela ne saurait être. Quelle est la cause de votre trouble, que je lui fasse promptement un sort ?
— J'apprends en lisant votre blog que vous en voulez à ma santé pour vous enrichir.
— Je ne comprends pas ce que vous dîtes mais puis néanmoins d'ores et déjà protester de mon innocence. Votre teint de rose est pour moi le plus précieux des trésors et je mourrais plutôt que de le flétrir.
— Mais voilà une semaine qu'un médecin déverse ses jérémiades sous un de vos billets, et vous restez coi ! Certes, l'auguste praticien, qui est une auguste praticienne, est parfaitement hors sujet puisqu'il s'agit du billet sur la médiatisation de votre cravate. Mais qu'apprends-je ? Les médecins exercent désormais la peur au ventre ? C'est l'existence même de leur art qui est menacée par vous et vos assignations pour un oui ou pour un non ?
— Mes assignations sont comme mes clients : innocentes. Je ne pratique pas la responsabilité médicale, même si je connais un peu la matière.
— Si ce n'est toi, c'est donc ton confrère, dirait la fable.
— Et elle aurait raison, car j'approuve le principe de demander des comptes à un médecin.
— Ah, vous avouez donc ? Vous haïssez les carabins ?
— Non, point, je les aime et les respecte. Des gens qui arrivent à apprendre tant de choses en buvant autant quand ils ne font pas l'amour en tout temps forcent l'admiration pour les moines que sont les étudiants en droit.
— Mais ce que dit la disciple d'Hippocrate…
— …Est une parfaite synthèse des clichés sans cesse ressassés par une profession qui n'apprécie guère ce qu'elle ressent comme une remise en cause de son autorité, ce à quoi il faut ajouter une absence de culture juridique — cette matière étant absente de leurs interminables études, alors que l'économie a été — peut-être l'est-elle encore ?— en PCEM1. Or la responsabilité n'est que la contrepartie logique et naturelle de la liberté du médecin. Loin de la fuir, ils devraient la revendiquer. À tout le moins, la rapporter à de plus justes proportions. Si tous les médecins ont entendu parler d'un confrère qui connaît un confrère qui…, combien ont été attaqués, eux personnellement, en justice ? J'entends une assignation en bonne et due forme, pas des menaces de procès. J'assume la part des avocats dans la mise en cause de la responsabilité des médecins, mais décline celle des fâcheux.Les avocats sont d'ailleurs responsables de leurs fautes et doivent en indemniser leurs clients. Si parfois certaines jurisprudences nous paraissent critiquables, nous n'avons jamais eu l'idée de remettre en cause le principe. Au contraire, c'est un argument qui éveille la confiance de nos clients. Nous ne prétendons pas à l'infaillibilité (c'est cela qui serait inquiétant) mais nous garantissons que vous serez couvert des conséquences de nos erreurs. Alors, donnez moi la main, chère lectrice, je vous emmène faire un tour dans le monde passionnant de la responsabilité médicale, où les clichés ont la vie aussi courte qu'un virus de la grippe dans le cabinet d'un médecin.
La responsabilité médicale, une vraie spécialité
Des avocats se sont spécialisés dans le droit des victimes. Le terme de victime étant très large et donc très flou, les avocats préfèrent parler de préjudice corporel : c'est cela que l'avocat veut voir réparer. Réparer une victime relève d'autres mains que les notres. C'est une spécialité reconnue, et une discipline à part entière. Les dossiers de “corpo” ont principalement trois sources : les accidents de la circulation, les infractions pénales, et la responsabilité médicale. S'y ajoute des sources ponctuelles, isolées mais au nombre de victimes élevé, comme les accidents sanitaires (sang contaminé, hormone de croissance, hépatite C) et les catastrophes maritimes ou aériennes.
Ces trois matières ont des règles de droit différentes qui leur sont applicables ; mais elles ont en commun le travail d'orfèvre que constitue l'évaluation exacte de ce préjudice, sans rien oublier. Là est tout l'art de l'avocat en “corpo”.
Mais ce n'est qu'aux règles présidant à la mise en cause de la responsabilité que je vais m'intéresser ici. À quelles conditions peut-on demander des comptes à celui qui, voulant vous soigner a failli à sa mission ?
Comme d'habitude en France, il faut distinguer selon que le médecin a agi en tant qu'agent de l'État ou en tant que praticien libéral.
Le point commun à toutes ces situations est néanmoins à garder à l'esprit : un patient venu se faire soigner a subi, à cause des soins reçus ou de l'absence des soins pertinents, un préjudice. Je reviendrai sur le préjudice. Sachez d'ores et déjà que le patient procédurier qui fait un procès pour un ongle cassé est un pur cliché. Dans la totalité des cas, ce sont des corps brisés, parfois au-delà du réparable, des vies à jamais bouleversées. Vous verrez les exemples que je donnerai.
Heureux les agents publics : ils seront couverts
Notre hypothèse est que le dommage au patient est survenu dans un établissement hospitalier (on parle d'hôpital pour un établissement de soin relevant de l'État, et de clinique pour un établissement privé ; mais il y a des pièges comme l'Hôpital américain de Paris, qui comme son nom l'indique est une clinique française située à Neuilly Sur Seine). Le contentieux relève du juge administratif, et le défendeur est l'établissement hospitalier lui-même, pas le médecin. Ceci est une application générale du fait que l'État est responsable des agissements de ses fonctionnaires, et se substitue à eux pour réparer les dommages causés. Il peut ensuite régler ses comptes avec l'agent public fautif, en demandant le remboursement des sommes payées à la victime (action récursoire, quasiment jamais utilisée à ma connaissance) et en prenant des sanctions disciplinaires à son égard.
Arrête d'être lourde (je parle à la faute)
Jusqu'en 1992, le juge administratif exigeait que la faute ayant causé un dommage soit une faute “lourde”. Cette exigence se voulait le reflet de la particularité de la pratique médicale : un médecin ne saurait être tenu de guérir son patient. Il doit faire de son mieux. La faute lourde était donc l'hypothèse où, pour simplifier, le médecin a commis une faute qu'un autre de ses collègues n'aurait pas commis. La conséquence était néanmoins funeste, eu égard à la difficulté de la preuve. Bien des patients, incapables de prouver une faute lourde, du faut qu'au moment où celle-ci a été commise, ils étaient inconscients, ou fortement diminués, et incapables de porter un jugement sur les gestes du praticien, voyaient leur demande rejetée, avec des conséquences terribles pour eux : on parle de gens devenus invalides qui n'étaient pas indemnisés de ce fait.
Le 10 avril 1992, le Conseil d'État opère un revirement et désormais exige une simple faute. C'est l'arrêt Madame V.
— Cette Madame V. était-elle une chicaneuse désirant battre monnaie sur la tête des médecins ?
— Je vous laisse juge. Les faits remontent au 9 mai 1979. Mme V. était enceinte de son troisième enfant. Son obstétricien, qui avait détecté un placenta prævia[1] lors d'une échographie, avait décidé de pratiquer une césarienne quelques jours avant le terme prévu. Jusque là, rien de plus normal. Le placenta prævia est une complication connue, certes pas bénigne, mais que l'on sait traiter pour minimiser les risques. Ilse caractérise par un risque d'hémorragie sévère, pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; ajoutons à cela que l'anesthésie péridurale présente un risque particulier d'hypotension artérielle qui était déjà connu à l'époque, et les acteurs sont en place pour la tragédie.
Acte I : le médecin anesthésiste de l'hôpital administre à Mme V., avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur. Sur un terrain favorable. Acte II : Une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; le même praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre-indiqué compte tenu de son effet hypotenseur. Ce qui devait arriver arriva : une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix ; après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente. Acte III : à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque de la patiente.
— Mon Dieu ! Mais qu'est-il arrivé à Mme V. ?
— Mme V., alors âgée de 33 ans, est restée atteinte de graves séquelles à la jambe gauche et, dans une moindre mesure, au membre supérieur gauche ; elle souffre à vie de graves troubles de la mémoire, d'une désorientation dans le temps et l'espace, ainsi que de troubles du caractère ; elle a dû subir une longue période de rééducation ; du fait de son handicap physique, elle subit un préjudice esthétique ; enfin elle exerçait la profession de maître auxiliaire dans un collège d'enseignement secondaire et qu'elle a perdu toute perspective de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses titres universitaires.
— Et vous me dîtes que ce fut un revirement de jurisprudence ?
— Oui. En 1986, un tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation. Voilà le paradis perdu de notre mélancolique esculape. Pour info : le Conseil d'État a alloué un million de francs à Mme V., 300.000 francs pour son mari pour le préjudice moral consistant à voir son épouse devenue invalide à vie et n'ayant plus tout à fait la même personnalité, et pour le trouble dans ses conditions d'existence, lui qui s'est retrouvé du jour au lendemain avec trois enfants et un adulte à charge.
— Ce n'est pas cher payé.
— Jamais devant le juge administratif.
— Faut-il toujours prouver une faute pour engager la responsabilité ?
— Non. Il existe deux cas où le patient victime est dispensé de prouver la faute : si cette faute est présumée ; et le cas particulier de l'aléa thérapeutique.
La faute présumée
— Le Conseil d'État a créé un régime de responsabilité pour faute présumée : c'est l'arrêt Dejous de 1988. Cette hypothèse s'applique à des hypothèses dans lesquelles un acte de soin courant à caractère bénin entraîne des conséquences très graves sans commune mesure avec le motif initial de l'hospitalisation. Il s'agissait principalement des infections nosocomiales[2].
— Je tremble en posant la question, mais que s'était-il passé dans cette affaire ?
— Le patient avait été hospitalisé pour subir une sacco-radiculographie[3] qui a confirmé la présence d'une hernie discale, qui a été opérée le lendemain (opération de cure de hernie discale). Il s'agissait d'une opération courante. Néanmoins, le patient s'est vu infecté par une infection méningée compliquée d'une lésion de la moelle dorsale. Cela a causé au patient des douleurs que je vous laisse imaginer, et l'a laissé atteint d'une paralysie des membres inférieurs, de l'abdomen et de la partie basse du tronc, entraînant une invalidité définitive de 80 %. Vraiment, il y a des gens qui font des procès pour n'importe quoi.
— Ne soyez pas ironique. Mais j'ai cru comprendre que vous employiez le passé ?
— Oui, les cris d'orfraie des médecins ont porté leurs fruits, puisque la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients (sic .) a mis fin à cette jurisprudence en matière d'infections nosocomiales. Si la même mésaventure vous arrive, vous devrez désormais démontrer qu'il y a eu une faute d'asepsie, sachant que le fait que vous avez été infectée ne démontre pas cette faute. Bonne chance. Mais vous comprendrez, c'est pour restaurer la dignité froissée des médecins.
Vous me prendrez un aléa matin, midi et soir
La jurisprudence administrative a développé trois cas de responsabilité sans faute. Cette expression, qui fait bondir les médecins, doit être bien comprise. Il ne s'agit absolument pas de dire que le médecin est responsable même s'il na commis aucune faute. C'est l'État, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives en matière de santé publique, pour lesquelles il s'est arrogé un monopole, qui est responsable. Le fait que ces responsabilités soient engagées sans faute exclut même toute action récursoire ou disciplinaire contre le médecin qui en serait à l'origine. Bref, le patient ET le médecin sont protégés.
Le premier cas est celui lié à l'hospitalisation des malades mentaux, et garantit les tiers. Dans les années 60, un dément qui avait été placé à l'extérieur, dans une ferme expérimentale, incendiait le bâtiment au cours d'un épisode délirant. Les propriétaires des murs ont pu être indemnisé, quand bien même ce placement dans un milieu ouvert n'était pas fautif en soi : il fallait bien essayer, et ces placements ont d'ailleurs produit de très bons effets sur d'autres malades.
S'agissant des patients, la Responsabilité sans faute couvre trois domaines :
► la technique nouvelle[4], quand on emploie une thérapeutique nouvelle dont les risques sont mal connus, et que ce recours ne s'imposait pas pour des raisons vitales et qui a eu des conséquences exceptionnelles et anormalement graves en découlant directement ;
► l'acte à risque[5], acte qui présente un risque exceptionnel mais mal connu, qui a entraîné directement un dommage anormal et d'une exceptionnelle gravité.
► et la transfusion sanguine, en cas de contamination par cette voie. Notons que la loi a créé un organisme, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). C'est cette organisme qui indemnise les victimes d'infections nosocomiales et affections iatrogènes[6], les transfusés infectés par le VIH (mais pas l'hépatite C), les victimes de l'hormone de croissance et les victimes de surirradiation au centre hospitalier Jean Monnet d'Épinal.
— Cette dernière précision me paraît bien étrange. Si j'ai été surirradié ailleurs ?
— Hé bien, ce n'est pas leurs ONIAM.
— Je vous sens fatigué, mon cher maître, pour en tomber au niveau des calembours. Il est temps pour vous de prendre des vacances, mais pas avant, je vous prie, de me dire s'il y a une explication à ce traitement, si j'ose dire, bien particulier ?
— Oui. La politique de la rustine et du cas par cas, qui a remplacé depuis longtemps à la tête de l'État toute vision de haut pour gérer la chose publique. La presse s'en émouvait, il importait dans l'urgence de faire quelque chose, n'importe quoi. C'est cette dernière solution qui a été retenue.
— Et dans le privé, qu'en est-il ?
Le contrat médical
— Les règles sont différentes, car c'est le Code civil qui s'applique. Le principe a été posé en 1936, par l'arrêt Docteur Nicolas contre époux Mercier. Avant cet arrêt, la jurisprudence refusait d'admettre que le lien qui unissait le patient et son médecin était un contrat.
— Qu'était-ce ?
— Bonne question. Autre chose. Une relation sui generis, de son propre genre, qui obligeait le patient à payer son médecin, mais qui dégageait le médecin de toute responsabilité contractuelle du fait de son art, considérant qu'il était déjà bien bon de consentir à s'intéresser à son patient. La responsabilité du médecin ne pouvait être qu'extra-contractuelle, les médecins étant considérés comme une classe au-dessus des contingences terrestres que sont les contrats dans le cadre de leur exercice professionnel, avec leur patient du moins. Il n'a jamais été contesté que ce qui donnait droit au médecin d'exercer en son cabinet était un contrat, de bail ou de vente. En 1936, la Cour de cassation met enfin cette absurdité à la poubelle et pose la règle qui s'applique encore aujourd'hui :
" il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidemment de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques (…) mais consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ".
Admirez au passage l'élégance de la langue.
L'évidence de l'énoncé est toutefois encore à ce jour restée en travers de la gorge de bien des médecins old school, comme on dit en bon français, la plupart ayant toutefois parfaitement intégré cet état de fait, et surtout compris que le mot contrat n'est pas un gros mot. Après tout, les médecins louent ou achètent les murs de leur cabinet, ainsi que tout le matériel qu'ils utilisent, ils ont passé une convention avec les caisses de sécurité sociale pour que leurs honoraires soient pris en charge par la collectivité plutôt que par leur patient, à charge pour eux de les maintenir à un niveau modéré fixé par la convention. D'où le terme de médecin "conventionné". Alors si la sécurité sociale est assez bien pour passer un contrat avec les médecins, pourquoi un patient ne le pourrait-il avec son médecin ?
Cet arrêt pose le principe, jamais démenti à ce jour, que la responsabilité du médecin ne peut être engagée qu'en cas de faute.
— Faute lourde ou faute simple ?
— Vous parlez chinois pour un juriste du droit civil. Le droit civil ne connaît qu'une faute, la faute. En matière contractuelle, c'est la violation du contrat. Si l'obligation principale du patient est de payer son médecin, l'obligation principale du médecin est de donner des soins attentifs, consciencieux et conforme aux données acquises de la science. Elle se détermine en comparant le comportement qu'a eu le médecin à celui qu'aurait eu dans les mêmes circonstances le bonus medicus, le bon médecin, consciencieux, attentif et qui se tient à jour des données acquises de la médecine. Notez bien : acquises. Pas actuelles. La jurisprudence refuse encore à ce jour d'exiger une mise à jour instantanée des connaissances des médecins, ni qu'ils soient au courant des moindres découvertes publiées. Il faut que ces données fassent consensus et soient largement répandues.
— Et l'aléa thérapeutique ?
— Rien de tel en droit privé. Les règles du droit public ne sont pas transposables en droit privé, le secteur libéral de la médecine n'exerçant pas de prérogatives en matière de santé publique. Le monopole des médecins, pénalement protégé[7], est un monopole fondé sur la protection du patient, pas de la profession médicale. Cependant, ne pas informer un patient de l'existence d'un risque lié à une technique nouvelle ou à un acte à risque est une faute.
Cela dit, il est des hypothèses où la responsabilité du médecin est engagée sur un fondement extra-contractuel, par exemple si le contrat est nul, ou si le patient, inconscient, n'a pu donné son consentement qui seul peut former le contrat. Consentement qui doit être éclairé, c'est là une autre obligation du médecin.
Au fait, docteur, j'ai quoi ?
— Ah, l'obligation d'information, n'est-ce pas là que le bât blesse certains médecins ?
— Je vous laisse la responsabilité de l'image du bât, mais oui, car là encore, beaucoup ne comprennent pas le sens de cette obligation. Le patient doit consentir au geste médical qui est la prolongation du contrat médical (dont le premier acte est le diagnostic et la proposition de traitement). Et ce consentement doit être éclairé. Éclairé par qui ? Mais par le médecin. Il est hors de question, s'agissant du corps et de la vie d'un être humain, de demander que le patient se remette entre les mains de son praticien.
— Certes, mais le patient est-il le plus à même de donner ce consentement ?
— À ce jour, on n'a pas trouvé mieux. L'information donnée par le médecin n'a pas à être une démonstration scientifique : la jurisprudence exige une « information loyale, claire et appropriée ». Elle a évolué : si autrefois elle se contentait d'une information sur les risques prévisibles, depuis deux arrêts de 1998[8], c'est la gravité du risque qui détermine l'étendue de l'obligation d'information. Si les risques les plus courants doivent être signalés, les risques les plus graves, même s'ils sont exceptionnels, doivent l'être aussi. Ces risques graves sont “ ceux qui sont de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques et sociales ” selon les mots du Conseiller Sargos, rapporteur dans les arrêts de 1998.
— Cette exigence n'est-elle pas sévère pour le médecin ?
— Ne pas la poser serait sévère pour le patient. Nous ne sommes plus dans la France des années 30 : les français sont plus éduqués, moins illettrés. On peut les traiter enfin en adultes, comme d'autres pays le font depuis longtemps, même si cela a dû se faire, là aussi, à coups de procès (oui, je pense au pays qu'un océan sépare de nous).
— Ne connaît-elle point d'exceptions ?
— Je vous reconnais bien là : vos questions paraissent naïves mais montrent bien que vous avez bien appris vos leçons. Oui, le droit est la science des exceptions, et il en va ainsi ici : il faut que le patient soit en état de recevoir l'information et de donner son consentement. L'urgence prime : si le patient est inconscient ou en danger de mort, le praticien est dispensé de son obligation d'information. De même, le code de déontologie médicale, approuvé par la jurisprudence, accepte que cacher la vérité au patient sur son état de santé n'est pas fautif, si cette vérité est celée dans l'intérêt du patient.
Ceux d'entre vous qui ont eu à fréquenter récemment un cabinet médical ont pu constater que cette obligation d'information n'est quasiment jamais respectée. Ainsi n'ai-je pas été considéré comme digne de connaître le nom de la dernière affection ayant frappé ma fille, encore moins d'être informé du choix du traitement effectué. Peut-être devrais-je aller aux consultations en robe ?
Notons pour conclure sur ce point que l'étendue de l'obligation d'information varie aussi selon la nature de l'acte de soin envisagé. En médecine “de confort”, je pense particulièrement à la chirurgie esthétique de patients dont la seule affection est l'injure du temps, l'obligation d'information est particulièrement étendue : elle doit porter sur les risques mais aussi les inconvénients pouvant en résulter. Par exemple, la pose d'implants mammaires modèle Zeppelin doit faire l'objet d'une information non seulement sur les complications possibles de l'opération, le risque de perçage des poches, mais aussi sur les douleurs au dos du fait de ce surpoids que le corps n'a jamais eu à porter.
L'obligation de sécurité, ou : prière de ne mourir que de votre pathologie dans l'enceinte du cabinet
— Est-ce là la seule obligation du médecin ?
— Non point. Ce serait dommage de faire tant d'années d'études pour avoir une seule obligation, n'est-ce pas ? Cette obligation de soin est l'obligation principale du contrat ; mais il y a une obligation accessoire, l'obligation de sécurité, qui connaît une extension régulière du fait de son attrait, puisque, contrairement à l'obligation principale de soin, qui est une obligation de moyens, l'obligation accessoire de sécurité est une obligation de résultat.
— L'obligation de moyen oblige simplement à des diligences sans s'engager sur le résultat, tandis que dans l'obligation de résultat, le fait que le résultat visé ne soit pas atteint caractérise la faute, n'est-ce pas ?
— Demogue n'aurait pas dit mieux.
— Qui est ce Demogue ?
— René Demogue, l'inventeur de la distinction obligation de moyen - obligation de résultat. L'obligation de sécurité impose au médecin, de garantir son patient de dommages qui ne sont pas liés à l'affection le frappant ou l'évolution de celle-ci. Citons ainsi la qualité des prothèses (dentaires ou de membres) et des instruments utilisés, et des accidents survenus dans l'établissement de soin, tels que des chutes de table d'opération, des brûlures causés par des instruments défectueux, etc.
Parlons faute
— Auriez-vous quelques exemple de fautes médicales retenues pour engager la responsabilité d'un médecin ?
— Trois. Une femme se présente à un hôpital pour la visite du sixième mois de grossesse. Le même jour dans la même salle d'attente se trouve une femme au nom de famille identique venue se faire ôter un stérilet. L'interne appelle la patiente au stérilet, c'est la femme enceinte qui se lève. La patiente ne parlant pas français (elle est viet-namienne), il ne fait pas d'interrogatoire et consulte le dossier. Voyant qu'il s'agissait du retrait d'un stérilet, sans faire le moindre examen qui aurait révélé une grossesse de six mois, il entreprend de retirer le stérilet avec une canule de Novack. La poche des eaux est percée, et la patiente est hospitalisée pour voir si la poche se reconstitue ou si'l faut provoquer un avortement thérapeutique. Le même médecin tentera ensuite de procéder au retrait du stérilet et n'y arrivant pas, prescrit une intervention chirurgicale. Il se produira un nouveau quiproquo est c'est la femme enceinte qui sera expédiée au bloc. Cette faute sera sans conséquence, la crise d'hystérie de la femme ayant attiré l'attention de l'anesthésiste qui reconnaîtra la patiente. Totuefois, la poche ne se reconstituera pas et le fœtus mourra. Source : cour d'appel de Lyon, 13 mars 1997.
— On croit rêver.
— Pincez-vous alors. Soit une patiente qui va voir une nutritionniste pour un problème de surpoids. Sa nutritionniste lui conseille de recourir à une liposucion, et lui conseille d'aller voir pour cela un médecin… généraliste, qui s'avère être son époux. Celui-ci va procéder dans des conditions d'asepsie épouvantables : sur une simple table de soin, la ptiente posée sur une serviette éponge souillée, après qu'elle se soit elle même enduite d'alcool à 70 pour stériliser le champ opératoire. L'opération donnera lieu à six orifice sans changement de canule (il est même douteux que le médecin ait seulement mis des gants). Quand le soir même elle sera prise de fièvre et de douleurs insupportables à la jambe, le médecin lui prescrira… du repos et une barre de vitamines. Ce n'est donc que douze heures plus tard qu'on lui diagnostiquera son embolie gazeuse, qui nécessitera sept interventions chirurgicales.
— Là, on cauchemarde.
— Non, voici un cauchemar. je serai peu disert, l'affaire est en cours. Soit des parents d'un nouveau né en pleine santé, placé en observation en réanimation néo natale car légèrement prématuré. Un jour qu'ils viennent le voir, ils apprennent qu'il est mort pendant la nuit. Aucune explication n'est donnée sur les causes du décès. Le personnel évoque vaguement une mort subite du nourrisson. Ils demandent donc une autopsie qui révèle un coup violent à la tête. Pour le médecin, pas de doute : le bébé est tombé par terre d'une grande hauteur. Car il était tenu dans des bras. Le personnel fait bloc et personne ne veut dire qui a commis la maladresse. Un non lieu est donc probable. À vous de me dire maintenant si les avocats font des misères pour des broutilles à d'honnêtes médecins qui font de leur mieux.
— Vous me permettrez de reste coite un instant.
Qui paye ?
— Parlons d'argent, voulez-vous ?
— Je suis avocat : c'est mon sujet de conversation préféré.
— Qui paye ?
— Quand la responsabilité relève d'un établissement hospitalier, l'État. Quand c'est un praticien du privé, c'est le médecin, ou s'agissant d'une clinique, la clinique elle-même. Concrètement, leur assurance, même si, contrairement à nous les avocats, les médecins ne sont pas obligés d'être assurésMISE À JOUR : obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002 (art. L. 1142-2 du Code de la Santé Publique [Merci Poggio]. Ce qui est une folie, puisque quand un médecin se plante, les dégâts peuvent être considérables.
Qui t'a fait toubib ?
—Une question impertinente me vient à l'esprit…
— Connaissant votre esprit, je frémis avant l'impact.
— Vous n'êtes pas médecin.
— Non, mais ce n'est pas une question.
— La voici : qui êtes-vous pour dire qu'un médecin a commis une faute ?
— Personne. Pas plus que le juge, cela dit.
— Est-ce une excuse ?
— Non, mais l'ignorance est plus supportable quand elle est équitablement partagée. C'est sur ce pilier que reposent tous les comptoirs de café du commerce. De fait, pour dire qu'un médecin s'est trompé, nous faisons appel… à un médecin. Tous ces dossiers donnent lieu à une expertise judiciaire. Zythom nous parle avec talent de son activité d'expert judiciaire en informatique. Un médecin fait de même, mais n'autopsie pas des serveurs ou des disques durs.
— Cela marche comment ?
— Très simplement. On ne choisit pas son expert, c'est le juge qui le désigne. L'adversaire doit être mis en cause pour pouvoir participer aux opérations et éventuellement avoir son mot à dire sur l'expert. Cette désignation se fait en référé, aussi bien au judiciaire (art. 145 du CPC) qu'à l'administratif (art. R.532-1 du CJA). L'expert se fait communiquer le dossier médical complet, épluche les compte-rendus opératoires, convoque les parties à une réunion d'expertise où la victime sera examinée en présence des avocats, du médecin ou de l'établissement mis en cause. Les avocats en “corpo” se font assister d'un médecin conseil, qui leur apporte leurs lumières. L'expert rend ensuite un rapport répondant aux questions et remarques faites par les parties, et c'est sur la base de ce rapport que les avocats vont ensuite s'étriper en toute confraternité. Vous voyez donc que ce droit n'existe pas contre les médecins, puisque des médecins y participent. J'ajoute que dans neuf cas sur dix, les victimes se plaignent surtout de ne rien savoir, que personne ne leur ait expliqué exactement ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé (ou à leur proche décédé). Il y a des réunions d'expertise qui sont des moments poignants, quand enfin le médecin exprime les regrets qu'il ressent, surtout quand il réalise la gravité de l'état de la victime. Un procès en responsabilité est une épreuve pour la victime mais aussi pour le médecin. Les deux ont un travail sur eux-même à effectuer, et si celui de la victime est le plus dur, les médecins y sont les moins préparés. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de réparation. Personne ne dit qu'ils sont indignes de leur profession (une éventuelle action disciplinaire relève de l'Ordre des médecins), mais que sur ce coup là, ils se sont plantés, et qu'il faut réparer ce qui, sans leur erreur, ne serait jamais arrivé.
L'inévitable arrêt Perruche
— Une dernière question, si vous le permettez ?
— Chère lectrice, avec moi, vous avez toute licence.
— Je n'en attendais pas moins de vous. Il me souvient d'un arrêt au nom d'oiseau qui a défrayé le chronique…
— L'arrêt Perruche.
— Celui-là même. Je crois me souvenir qu'il s'agissait d'une femme enceinte qui avait subi un examen pour diagnostiquer une éventuelle rubéole, maladie qui présente de graves danger pour le fœtus. Elle avait clairement dit que si elle était positive à ce myxovirus, elle se ferait avorter, ne désirant prendre le risque d'avoir un enfant atteint des graves malformations que provoque cette maladie.
— Votre mémoire ne vous trompe pas.
— L'examen fut négatif.
— Ô combien ! En fait, il fut positif, mais interprété à tort comme négatif.
— En effet puisqu'en réalité, elle était bien atteinte du rubivirus, et elle donna naissance neuf mois plus tard à un petit garçon atteint de graves séquelles neurologiques.
— Nicolas. Invalide à 100%.
— Il était donc acquis que si le diagnostic avait été correctement posé, la mère aurait pratiqué une IVG.
— Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute.
— Pourtant, l'enfant fit un procès au médecin ayant commis l'erreur de diagnostic.
— Ses parents, en son nom, pour être exact.
— Et il triompha.
— Je vois mal comment il aurait pu en être autrement.
— Mais enfin ! Vous vous gaussez ? Cet enfant ne pouvait de plaindre que d'être né, que d'avoir échappé à l'avortement, puisqu'aucun traitement n'aurait pu prévenir les dommages qu'il a subis. La vie, fût-elle handicapée, est-elle un préjudice ?
— Vous parlez comme un médecin, ou pire un moraliste. Je vous demande de parler en juriste. Langue où les épithètes comptent. Nul n'a jamais prétendu que le préjudice subi par Nicolas Perruche était d'être né.
— Mais…
— Il est d'être né handicapé. Si vous escamotez cet article, vous vous condamnez à ne pas comprendre l'arrêt du 17 novembre 2000. Vous vous souvenez des trois mamelles de la responsabilité civile ?
— Absolument : la faute, le préjudice, et le lien de causalité reliant la faute et le préjudice.
— Exact. Ici, il y a eu faute : le médecin devait diagnostiquer la rubéole par le simple examen attentif des résultats (un premier échantillon a été négatif, un deuxième prélevé quinze jours plus tard positif ; le premier échantillon, testé à nouveau, fut positif, ce qui prouvait la présence d'une contamination récente par la Troisième Maladie). Le nierez-vous ?
— Non point.
— Ici, il y a eu préjudice : Nicolas est atteint depuis sa naissance de troubles neurologiques graves, frappé d'une surdité bilatérale, d'une rétinopathie qui va conduire inéluctablement à sa complète cécité, et d'une cardiopathie. Nierez-vous que cela est un préjudice ?
— J'en serais incapable.
— Enfin, il est établi que ces affections sont dues à la rubéole de la mère. Ça n'est nullement contesté d'ailleurs. Donc, il y a un lien de causalité entre la rubéole et les affections, et il est certain que si l'erreur n'avait pas été commise, Nicolas ne serait pas né handicapé ?
— Il ne serait pas né tout court.
— Donc pas né handicapé. Auquel cas il n'y aurait pas eu de préjudice. Voilà qui me semble établir un lien de causalité, sauf à insinuer que Nicolas devrait éprouver la plus grande reconnaissance à l'égard de ce médecin qui lui a sauvé la vie par erreur. Argument séduisant pour les mouvements anti-IVG, mais peut-être moins du point de vue (si j'ose dire) de Nicolas.
— Mais la vie n'est pas un préjudice !
— Non, mais la vie handicapée, oui. Vous voyez comme un épithète vous manque est tout est dépeuplé ?
— Était-il nécessaire de passer par ces circonvolutions aux limites de la morale, juste pour indemniser un enfant ?
— Laissez donc la morale où elle est, surtout si on l'invoque pour dire qu'un enfant naissant avec un tel handicap ne devrait pas être indemnisé de ce qu'il subit. Je ne l'aime pas, votre morale. Parlons plutôt du droit. Car cet arrêt avait un apport fondamental.
— Lequel ?
— Dans des hypothèses analogues, l'indemnisation des parents n'a jamais posé problème. Eux subissent un préjudice, et personne ne prétendra que c'est du fait d'être nés.
— Certes.
— Les parents de Nicolas ont d'ailleurs été indemnisés pour leur préjudice individuel consistant à devoir vouer leur vie à s'occuper d'un enfant lourdement handicapée alors qu'ils avaient exprimé leur refus d'une telle éventualité et avaient les moyens légaux de l'éviter.
— Fort bien.
— Mais cette indemnisation appartient aux seuls parents. Réparant leur malheur, libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent.
— Y compris autre chose que s'occuper de leur enfant ?
— Absolument. Hormis un poste particulier, le “préjudice d'éducation” qui indemnise la surcharge financière qu'implique élever un enfant polyhandicapé (cela peut inclure un voire deux voire trois salaires d'assistants à domicile !). Mais ce préjudice d'éducation n'existe que tant que subsiste l'obligation d'éducation. À 21 ans, 25 au plus tard, l'enfant devenu adulte est censé se prendre en charge lui-même. Tandis que l'indemnisation affublée du masque du « préjudice d'être né » appartenait en fait à l'enfant et entrait dans son patrimoine.
— Donc devait être consacré à l'intérêt de l'enfant et couvrait ses besoins pour sa vie entière !
— Vous avez compris. Et notamment, lors du décès des parents, l'État et les autres héritiers ne viennent pas en prélever une part pour leur compte, sans obligation de prendre soin de l'handicapé en contrepartie.
— Mais alors, loin d'être une décision injurieuse pour les handicapés, c'était une décision formidablement protectrice des handicapés !
— Était. Car les médecins sont venus crier famine chez le législateur, leur chœur étant repris, la farce était complète, par des associations d'handicapés.
— Le choux qui défend la chèvre ?
— Là encore, je vous laisse la responsabilité de la métaphore légumineuse. Et une loi du 4 mars 2002, oui, celle-là même sur les droits des patients, a mis fin à cette jurisprudence rendant toute action de ce genre purement et simplement irrecevable.
— Sans contrepartie ?
— Tout comme : il y eut une promesse en contrepartie, que ces personnes lourdement handicapées seraient prises en charge par la solidarité nationale. On attend encore les décrets d'application, à ma connaissance.
— Et cela a donné ?
— Une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, à l'unanimité des 17 juges formant la grande chambre. Saluée comme il se doit par Veuve Tarquine, qui précisément exerce dans cette redoutable discipline qu'est le “Corpo”.
— La connaissant de réputation, je devine le feu d'artifice…
— Un bouquet, du début à la fin. En conséquence, la cour de cassation a jugé récemment que les réclamations portées avant la loi du 4 mars 2002 seraient encore recevables, ce par un effet rétroactif d'application immédiate©. Pour aux enfants nés après le 6 mars 2002 : Vae Victimis. Maintenant, vous aurez l'obligeance de me dire où se trouve la morale. Pour ma part, je suis de ceux qui l'ont vu périr sous les applaudissements qui ont accueillis le vote de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002. Il est vrai que dans l'hémicycle, personne ne se souvient plus de ce à quoi elle ressemble, la morale.
— Je vous trouve bien amer.
— Il y a de quoi, et encore : moi, je n'ai pas eu de clients qui ont subi les conséquences de cette loi. Je suis lâchement soulagé de n'avoir pas eu à leur expliquer la nouvelle en les regardant dans les yeux.
— Maître, je vous remercie, j'ai trop abusé de votre temps. Je vous laisse partir en vacances, vous l'avez bien mérité.
— Merci, chère lectrice, mais de grâce, je vous en conjure ! Ne m'appelez pas maître, quand je ne suis que votre très humble et très dévoué serviteur.
Adresses utiles :
Le site de l'ANADAVI, Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels, avec la liste des avocats adhérents. Ils sont tous compétents en la matière et adhèrent en outre à des bonnes pratiques qui s'ajoutent aux obligations déontologiques communes à tous les avocats. Je précise que je ne suis affilié d'aucune manière à cette association, je serais plutôt de l'autre côté de la barre.
Le site de l'ANAMEVA, Association Nationale des Médecins Conseils de Victimes d'accident avec dommage corporel. Auxiliaires précieux des avocats, ils les assistent lors des expertises qui visent à établir la faute et le préjudice.