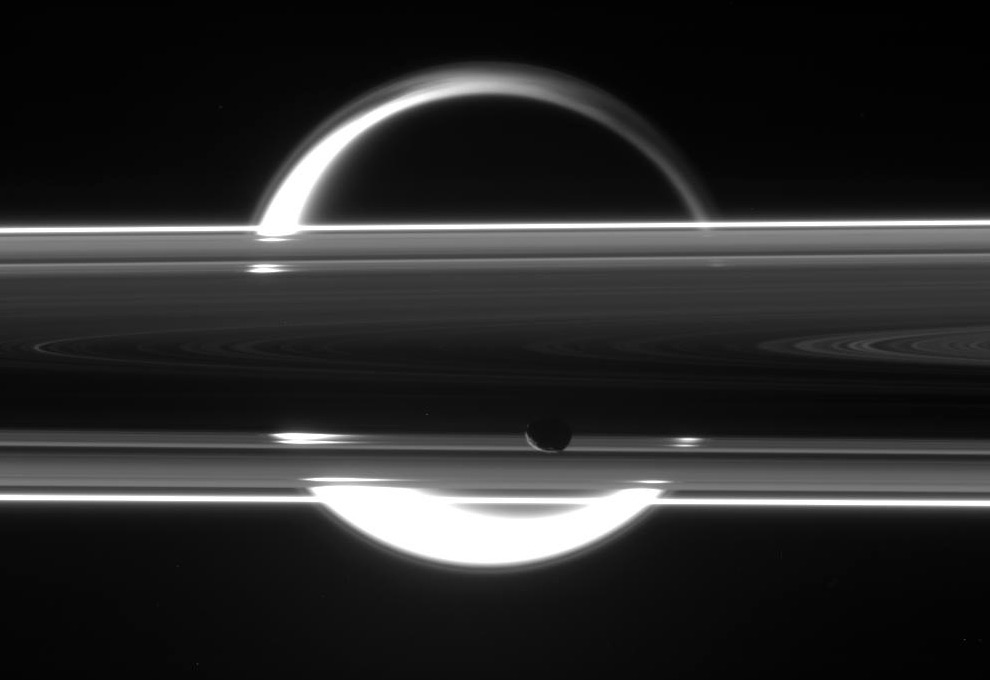Bon, au début, je souriais, mais le pétage de plomb généralisé qui saisit la classe politique ne m'amuse plus. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1er avril dernier (cette date n'aurait pu être mieux choisie) annulant un mariage à la demande du mari ayant découvert que son épouse en savait un peu trop donne lieu à un festival d'outrances comme j'en ai rarement vu. D'autant plus que l'unanimité n'est que de façade, car personne ne le condamne pour les mêmes raisons. Et pour cause, il y a gros à parier que personne ne l'a lu, ce jugement. Car il ne casse pas trois pattes à un canard boîteux, comme disait ma grand-mère, qui, elle était vierge (ascendant sagittaire).
Et là où je commence même à ressentir les premiers symptômes d'un agacement certain, c'est quand on répète en boucle que les époux étaient musulmans. Argh, l'Islam nous impose sa loi (la virginité de l'épouse n'ayant jamais préoccupé les chrétiens, c'est connu), les juges plient, la République est en danger, la laïcité agonise, que fait la police ? Ah, oui, elle est occupée.
Alors de quoi s'agit-il ?
Tout d'abord, l'époux est Français. L'épouse, je l'ignore, le jugement est muet là-dessus. Pour des raisons philosophiques et religieuses, que précisément la laïcité républicaine nous interdit de juger, il voulait absolument épouser une jeune femme de la même confession, et vierge.
Il rencontre une jeune femme qui répond au premier critère et qui, leur relation devenant sentimentale, lui affirme qu'elle répond aussi au second, alors qu'il n'en est rien. Pourquoi ? Je l'ignore. Toujours est-il que son fiancé ne lui a jamais caché l'importance que ce critère représentait pour lui et qu'elle a prétendu mensongèrement le remplir.
Vient la nuit de noce, et le mari découvre que son épouse lui a menti, et sur un point dont il n'a jamais caché l'importance qu'il lui attachait. L'épouse lui révèle alors qu'elle a déjà eu une relation sentimentale qui, si elle n'a pas eu de fruit, lui a coûté une fleur.
L'époux ne veut plus de cette union qui s'est construite sur un mensonge. Dès le soir des noces, il se sépare de son épouse et veut faire dissoudre ce mariage.
Il saisit donc la justice, mais par une procédure fort rare, la nullité du mariage. Quasiment tombée en désuétude depuis la libéralisation du divorce en 1975, elle n'est plus enseignée à la faculté que comme une curiosité, ses effets divergeant de la nullité contractuelle de droit commun.
Cette nullité repose sur l'article 180 du Code civil :
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Cet article protège le consentement des époux, qui doit être libre et sincère. C'est là un point essentiel du mariage. Le mariage tient en effet à la fois du contrat (un accord de volonté qui fait naître des obligations) et de l'institution (certains de ces effets et sa dissolution sont fixés par la loi et ne sont pas laissés à la liberté de choix des époux). Sa nature contractuelle exige un consentement pur : monsieur veut vraiment épouser madame.
Cela exclut que monsieur soit menacé de mort s'il ne dit pas oui (je n'invente pas : c'est une jurisprudence de la cour d'appel de, je vous le donne en mille : Bastia, 27 juin 1949), ou subisse quelque pression que ce soit. C'est le sens de la question posée par le maire : voulez-vous prendre pour époux … ?
Outre la violence faite aux époux, l'alinéa 2 prévoit que le consentement d'épouser la personne porte non seulement sur son identité mais sur qui elle est vraiment. Tout couple, a fortiori un couple qui se lie par le statut contraignant du mariage, repose sur la confiance en l'autre. Si cette confiance a été trahie avant même le mariage, la loi considère que le consentement au mariage peut en être atteint.
Mais la loi se garde de définir ces qualités essentielles, et la jurisprudence de la cour de cassation laisse le juge décider si, selon lui, les qualités invoqués sont ou non essentielles. On appelle cela le pouvoir souverain du juge du fond, la cour de cassation n'étant pas juge du fond mais du droit. Seules exigences de la jurisprudence : l'erreur doit être objective et déterminante, c'est-à-dire reposer sur un fait et être telle que, sans cette erreur, l'époux ne se serait pas marié.
On a donc une collection de décisions qui donnent des exemples ponctuels. Ont ainsi été considérés comme qualités essentielles :l'existence d'une relation extraconjugale que l'époux n'avait nullement l'intention de rompre ; la qualité de divorcé (qui fait obstacle à la tenue d'un mariage religieux chrétien) ; la qualité d'ancien condamné ; la qualité de prostituée ; la nationalité ; l'aptitude à avoir des relations sexuelles normales (le jugement ne définit pas la relation sexuelle normale, pour la plus grande tristesse des étudiants en droit) ; la stérilité ; la maladie mentale ou le placement sous curatelle.
Venons-en à notre jugement. Sa lecture est fort instructive. Dommage que les spécialistes de l'indignation sur commande s'en soient manifestement passés.
Premier point intéressant. Contrairement à ce que Libé laisse entendre en écrivant «Dès le lendemain, l’époux cherche à faire annuler son mariage », les époux n'ont pas fait preuve d'un empressement frénétique. L'époux a délivré son assignation fin juillet 2006, soit trois semaines après le mariage, et il ne va plus rien se passer pendant plus d'un an. Ce qui va faire que le tribunal, lassé d'attendre va radier l'affaire le 4 septembre 2007, qui sera rétablie pour être jugée en octobre 2007. Mais bon, le mari musulman qui répudie sur le champ sa femme pas assez chaste, c'est plus vendeur, n'est-ce pas ?
Une procédure en nullité de mariage, c'est un procès presque comme un autre. Il y a un demandeur. Ici, c'est le mari. Il expose au juge ses prétentions, que voici :
il demande l' annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 du code civil, que chacune des parties supporte ses propres dépens. Il indique qu'alors qu'il avait contracté mariage avec [son épouse] après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit même des noces. [son épouse] lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale, il demande l' annulation du mariage.
Il y a un défendeur. Ici, c'est l'épouse. Et que dit-elle pour sa défense ? Voilà ce que tous les indignés oublient de dire ou ignorent :
Elle demande au tribunal de lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par [son époux], dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Bref, l'épouse consent à la procédure de nullité.
Le mariage, en France, comme tout ce qui touche à l'état des personnes, est d'ordre public : la procédure doit être communiquée au parquet pour qu'il indique sa position. Il faudra qu'un jour je fasse un billet sur le rôle civil du parquet, qui est très important et méconnu, on ne lui connaît que son rôle pénal de poursuite des infractions.
Dans ce dossier, le parquet dit : « Je m'en rapporte à la sagesse du tribunal », ce qui signifie que ça ne lui pose aucun problème.
Mettons nous un instant à la place du juge : il a un demandeur qui lui demande d'annuler son mariage car son épouse l'a trompé. Il a un défendeur qui lui demande d'annuler son mariage car il a trompé son époux. Il a un procureur qui dit de ne pas l'ennuyer avec ce dossier, car il y a un nouveau billet sur le blog d'Eolas. Et il a un article 408 du Code de procédure civile qui lui dit :
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Pourquoi diable le juge rejetterait-il cette demande qui ne pose de problème à personne ?
Certes, le même article 408 précise que :
[L'acquiescement] n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Ce qui n'est pas le cas de la nullité du mariage qui est d'ordre public. Il a le pouvoir légal de rejeter cette demande et l'obligation légale de la justifier s'il y fait droit.
Il va décider d'y faire droit, en motivant sa décision ainsi :
D'abord, il rappelle le droit tel qu'il va l'appliquer.
- Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 180 du code civil, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; que, par ailleurs, l'article 181 - dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause - précise qu'une telle demande n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ;
Simple rappel des textes en vigueur.
- Attendu qu'il convient en premier lieu de constater qu'en l'occurrence, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l'erreur ; que l'action en annulation du mariage s'avère dès lors recevable ;
Premier point qu'il doit vérifier : la demande est-elle recevable, doit-il l'examiner ? La réponse est oui. Deuxième question, la demande est-elle fondée ? Ce qui induit la question : quelles sont les règles applicables ?
- Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;
C'est-à-dire que l'erreur ne vient pas de celui qui l'invoque mais était connu de l'autre époux, et que sans cette erreur, il n'aurait pas consenti au mariage.
Ces règles posées, le juge va constater qu'elles s'appliquent, et ce par un raisonnement fort habile qui fait que ce juge mérite plus des applaudissements que les injustes lazzis dont il fait l'objet :
Attendu qu'en l'occurrence, [l'épouse] acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de [l'époux] au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
L'habileté échappera à qui n'est pas juriste, mais je m'y attarde car c'est un superbe cas pratique pour des étudiants de première année (tiens ? Les partiels approchent…)
L'acquiescement de l'épouse à la demande en nullité n'était pas possible, car la matière est d'ordre public : art. 408 alinéa 2 du code de procédure civile. Alors que fait le juge pour faire droit à cette demande ? Étudiants en première année, prenez le temps de réfléchir, c'est un beau cas pratique du droit de la preuve.
Il déduit de cet acquiescement inefficace un aveu judiciaire : article 1356 du Code civil. L'épouse dit acquiescer à la demande de son mari. Elle ne le peut pas, mais ce faisant, elle avoue devant le juge qu'elle savait que son hymen importait à son époux et qu'elle savait qu'elle ne l'avait plus (son hymen, pas son mari ; quoique maintenant elle n'a plus ni l'un ni l'autre).
Le juge y trouve donc une preuve irréfutable (l'aveu judiciaire ne peut être rétracté) du caractère objectif et déterminant de l'erreur. Ite missa est, comme ne dit pas le Coran.
Et hop, mariage annulé.
Ce qui est une action d'une banalité affligeante, faite sur un fondement anecdotique, est devenu en quelques jours un scandale national car chacun y projette ses fantasmes, la religion musulmane des intéressés n'y étant pas pour rien, la palme revenant à ce communiqué de l'association Ni Putes Ni Soumises, que j'ai connue plus inspirée, et qui aboutit à faire dire à ce jugement que les femmes non vierges n'ont plus le droit de se marier.
Ce jugement ne dit absolument pas que le mariage d'une femme non vierge est nul, ni que la virginité est une qualité essentielle de la femme. Il dit ceci et rien d'autre. Madame Y… a menti à Monsieur X… sur un point qu'elle savait très important pour lui. Elle savait que si Monsieur X… avait su la vérité, il ne l'aurait probablement pas épousé. Et d'en tirer les conséquences légales que lui demandent les deux époux dans ce qui après tout est leur vie.
Là où les indignés des micros se muent tous en Tartuffe, c'est quand on se demande ce qu'il serait advenu en cas de rejet de la demande. Ces époux seraient-ils restés mariés et auraient-ils vécu heureux avec beaucoup d'enfants ? Non, ils auraient divorcé. Par consentement mutuel, puisqu'ils étaient d'accord pour se séparer. Consentement mutuel qui exclut que soient abordés les raisons du divorce. Donc dissolution du mariage, mais l'honneur est sauf : on ne saurait pas pourquoi.
Bref, prenez ce mouchoir et cachez-moi cette virginité que je ne saurais voir. Tartuffe est toujours face à Dorine.
Pour ne pas mourir idiot : Le texte presque intégral du jugement.