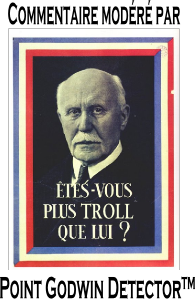Adoncques, en cette fin 2011, mon billet n’était point passé inaperçu, et, eu égard à l’ampleur relative que prenait cette pétition et la nouveauté du phénomène des Fake News sur Facebook, plusieurs médias se sont intéressés à l’affaire. L’association « Institut pour la Justice » (IPJ brevitatis causa car un billet sans latin est une Guinness sans mousse) a donc passé beaucoup de temps à lire mes écrits, ce qui est sans doute ce qu’il a fait de mieux dans son existence, et a retenu plusieurs cibles pour son offensive. Dans la presse généraliste tout d’abord.
Slate.fr le premier a publié le 22 novembre 2011 un article signé Julie Brafman intitulé « Ce qui se cache derrière l’institut pour la justice ». Dans cet article, le passage suivant a déclenché l’ire de cette association, ou plutôt comme on verra de son seul membre actif :
Cependant pour Maître Eolas, blogueur anonyme et avocat au barreau de Paris, cette progression vertigineuse serait factice: D’ailleurs, selon lui, l’ensemble de la démarche de l’IPJ relève de la «manipulation»: sur son blog, il consacre un billet-fleuve à la démonstration des erreurs, lacunes et faux-semblants de cette vidéo qui ne lui inspire «que du mépris».
Ce passage était accompagné d’un insert, en l’occurence un tweet de votre serviteur, où je reprenais une courbe de la progression du compteur de signature, courbe qui n’a de courbe que le nom, progression relevée automatiquement par un script fait par un de mes followers, et qui montrait sur un intervalle de 24mn une progression étrangement régulière. J’accompagnais cette publication du commentaire suivant : « compteur bidon des signatures de l’IPJ, voici la preuve. »
Le 30 novembre 2011, je fus invité chez feu Metro France pour un tchat en direct où je répondis à plusieurs questions. Las, ce tchat n’est plus en ligne, mais un des lecteurs me posa une question sur ledit compteur. À laquelle je répondis
Je ne crois pas une seconde à la sincérité de ce chiffre. Ce compteur est hébergé par l’Institut, de manière opaque, ce qui fait qu’il se donne à lui-même un certificat de victoire. Sa vitesse de progression, rapide et constante (et qui n’a connu aucun « effet Agnès » lors de ce fait divers terrible) me rend très sceptique. »
Je parlais du meurtre d’Agnès Marin, interne au collège Cévenol du Chambon-Sur-Lignon, survenu le 16 novembre 2011. L’IPJ y vit une diffamation sur leur compteur de signature, sujet qui décidément les rendait fort susceptibles. Petit aparté, lors de ce tchat, j’ai même pris la défense de l’Institut pour la Justice face à un lecteur me demandant si c’était une association d’extrême droite, lui répondant que je ne croyais pas que c’était un sous-marin de ce courant de pensée. La suite me donnera tort. Ça m’apprendra.
Enfin, l’IPJ se tourna vers mon compte Twitter et retint plusieurs tweets de ma plume consacré à cette affaire, en l’occurrence un où j’écrivais : « ça se confirme, l’IPJ a un compteur de signatures bidon. Manipulation, manipulation », le tweet cité dans l’article de Slate ci-dessus (j’étais donc poursuivi plusieurs fois pour le même tweet), et enfin, celui qui allait me faire entrer dans les anales, le désormais célébrissime (et à qui la faute ?) cacagate : « l’Institut pour la Justice en est réduit à utiliser des bots pour spammer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron » ; « je me torcherais bien avec l’institut pour la justice si je n’avais pas peur de salir mon caca. Une bouse à ignorer. Je le mettrais bien dans mes chiottes si je n’avais pas peur de les salir. »
Et dans ce dernier cas, j’ai un problème. Je suis bien en peine de mettre un lien vers ledit tweet -, non que je l’aie supprimé, je n’ai supprimé aucun des tweets de cette période. C’est que je ne l’ai jamais écrit. D’ailleurs, c’eût été impossible : mes toilettes sont beaucoup trop petites pour y faire entrer un institut. Mais surtout, à l’époque, les tweets étaient limités à 140 caractères, et le tweet en question en fait 155.
En fait, l’IPJ a fait un montage de trois de mes tweets, dont deux ne parlaient nullement de lui, mais du PACTE pour la justice, nom du pensum qu’ils tentaient de refourguer aux candidats à la présidentielle (et le président sortant, encore plus sortant qu’il ne le pensait d’ailleurs, Nicolas Sarkozy, s’est rendu en personne à un de leurs raouts ; je l’ai connu plus inspiré dans le choix de ses convives). C’est ce pacte, que l’IPJ vous appelait à soutenir (et à faire un don au passage), que j’appelais à ignorer dans un vibrant hommage aux bovidés qui fertilisent le terroir normand et que j’eusse mis dans mes chalets de nécessité si je n’avais craint de souiller leur parfaite asepsie (vous remarquerez que j’ai fait un réel progrès dans mon vocabulaire depuis, mes avocats y ont veillé). Et pour ceux d’entre vous qui douteraient (soyez bénis, c’est ce que je cultive et encourage ici) : voici le premier, qui répondait, le tweet ne semblant plus disponible mais j’en ai gardé copie, à « Qu’est-ce que c’est que ce pacte 2012? Une bonne chose ? Une historie vraie ? Merci. #Justice #2012 » voici le second, qui répondait à « Bonjour maitre. Que pensez-vous de ceci ? » (suivait un lien vers le site du pacte 2012 où se trouvait la vidéo). Comme disait un philosophe de l’époque : manipulation, manipulation. Je tenais à le souligner ici car l’avocat de l’IPJ, incapable d’utiliser un simple moteur de recherche, pas même celui que propose Twitter, n’a jamais été fichu de les retrouver (ce qui m’a pris cinq secondes), et a insinué que je les avais supprimés. Ils ne l’ont jamais été et sont toujours en ligne à ce jour.
S’agissant du désormais fameux tweet, oui, oui, je l’ai écrit. Là encore, c’était en réponse à une questions sur le pacte pour la justice. Je me souviens fort bien des circonstances dans lesquelles je l’ai écrit. C’était au milieu de la nuit, à 1h43 du matin. Je sortais de garde à vue, après une longue audition sur des vols en bande organisée, et avant d’enfourcher ma fière monture, j’ai checké Twitter. Je suis tombé sur un énième tweet me demandant mon avis sur le Pacte pour la Justice. Fatigué, agacé de devoir répéter sans cesse tout le mal que je pensais de cette opération de comm’ reposant sur de la manipulation et du mensonge, j’ai répondu par cette fulgurance qui m’est venue comme la Marseillaise est venue à Rouget de Lisle. J’ai cherché dans la littérature le souffle de Calliope, et c’est Rabelais qui m’a répondu. Las, au milieu de la nuit, au lieu d’écrire « Pacte » pour la Justice , j’ai écrit « Institut ». Fatalitas. Si on ne peut injurier un pacte (mais on peut se torcher avec), on peut insulter un institut (et on ne peut pas se torcher avec, ce serait trop douloureux). Ce qui est ironique, c’est que s’agissant d’un tweet en réponse, posté à point d’heure, au jour de la plainte, ce tweet avait fait l’objet de 8 vues et d’un seul retweet (au jour où j’écris ces lignes, il en a 11…), ce qui est ridiculement faible. Ce tweet, certes, pas le plus brillant de ma carrière, je dispense la Pléiade, le jour où elle publiera mes œuvres, de l’y faire figurer, ce tweet donc aurait dû passer inaperçu et rester dans les limbes de l’oblivion qui était son destin si l’IPJ ne lui avait pas donné une telle publicité, et une telle postérité. Le droit de la presse a été écrit par Damoclès.
Récapitulons. Au total, l’IPJ a déposé pas moins de huit plaintes.
- Contre Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, pour diffamation, pour mes propos sur le compteur bidon retranscrits dans l’article du 22 novembre 2011.
- Contre Julie Brafman, pour complicité de diffamation, comme auteur de l’article.
- Contre votre serviteur, pour complicité de diffamation, comme, heu, disons, auteur de la citation.
- Contre Edouard Boccon-Gibod, directeur de la publication de Metro France, pour diffamation, pour avoir publié mes propos lors du tchat du 30 novembre (il a d’ailleurs refusé de révéler mon identité au nom du secret des sources, respect bro).
- Contre votre serviteur, pour avoir tenus ces propos.
- Contre votre serviteur pour diffamation pour le tweet sur le compteur bidon, manipulation, manipulation ;
- Contre votre serviteur, pour diffamation pour le tweet sur le compteur bidon, la preuve avec la courbe pas courbe,
- Contre votre serviteur encore et enfin, pour injure, pour le tweet semi-imaginaire où je faisais de cette association un usage hygiénique non prévu par leur objet social.
Et comme vous allez le voir, l’IPJ va perdre peu à peu, à chaque stade de la procédure, et à chaque fois de manière particulièrement humiliante. Mais la justice n’est point comme le football : même si vous menez 7 à 1, vous avez perdu, car il suffit que votre adversaire marque un but pour se pavaner comme vainqueur. Il vous faut le 8 à 0, ou vous avez perdu. Et j’obtiendrai le 8 à 0, et c’est là une autre différence avec le football, uniquement grâce à mes défenseurs. Même s’il faudra pour cela aller aux prolongations. Mais n’anticipons pas.
La juge d’instruction saisie de ce dossier a confié une commission rogatoire à la Brigade de Répression de la Délinquance à la Personne (BRDP), habituellement saisie pour des dossiers de ce type. Sans rien retirer au mérite de cette prestigieuse brigade, me retrouver ne fut guère difficile. Ils se rendirent sur la page de mes mentions légales, écrivirent à mon hébergeur de l’époque, qui leur communiqua mes coordonnées comme la loi les y obligeait. La BRDP m’adressa une convocation pour une audition libre le 19 avril 2012, à laquelle je me rendis.
Et là je vous vois venir. Gardai-je le silence, comme je le conseille à cors et à cri ? Non. J’étais jeune. J’admis volontiers, sûr que mon innocence me protégerait, être l’avocat signant Maitre Eolas, et être l’auteur des propos tenus sur Metro France, et être le seul auteur de l’ensemble de mes tweets (à ce stade, le bricolage de trois de mes tweets m’avait échappé, n’ayant pas accès au dossier, accès qui, seule nouveauté, m’était refusé en qualité de témoin et non en qualité d’avocat) . Bref, je ne gardai point le silence, et vous noterez que par la suite je fus condamné à tort à deux reprises. Cela m’apprendra, que cela vous serve de leçon.
Cela dit, ce fut une audition tout à fait agréable, le policier en charge de l’enquête profitant de l’occasion pour me dire tout le bien qu’il pensait de mon blog nonobstant quelque désaccords de-ci de-là qui font tout le piquant des relations entre la maison noire et la maison bleue. J’en profite pour le saluer à l’occasion de ce billet qui inaugure un renouveau de mon blog à présent qu’il a trouvé des cieux plus cléments bien que bretons. Ce fut au demeurant une constante tout au long de cette procédure : je fus condamné avec la plus grande sympathie. J’avoue que je me serais satisfait d’une relaxe méprisante, mais c’est là une autre constante de la justice : on n’obtient pas toujours ce qu’on veut.
La seule information que j’avais à ce stade était que la plainte était déposée à Nanterre. S’agissant de textes publiés sur internet, l’IPJ pouvait choisir n’importe quel tribunal de France. Le choix de Nanterre n’est toutefois pas innocent (mais l’IPJ n’aime pas ce mot). Paris et Nanterre sont les deux gros tribunaux en droit de la presse, du fait que le siège de beaucoup de médias est dans les Hauts de Seine, et Nanterre s’est fait une réputation d’accorder des dommages-intérêts bien plus élevés qu’à Paris. Comme vous allez le voir, l’action de l’IPJ n’avait rien de symbolique, et les montants demandés sembleront calculés par le compteur de signature de la pétition.
La guerre étant ainsi déclarée, il était temps de faire ce que toute personne sensée doit faire dans ces circonstances : se taire (trop tard pour moi, mais j’ai décidé de garder un silence médiatique jusqu’à la fin de l’affaire), et prendre un avocat.
Même si je le suis moi-même. Surtout parce que je le suis moi-même. Outre sa connaissance du droit, un avocat vous apporte ce que vous avez perdu : une vision rationnelle et avec recul du dossier. Dès lors que vous êtes mis en cause, même dans une affaire de diffamation où la prison n’est pas encourue, vous n’êtes plus objectif. Et rien n’est plus dangereux que de croire que vous, vous êtes différent, et que vous pouvez gérer ça. C’est un conseil qu’un de nos respectables anciens nous avaient donné à l’école du barreau : le jour où VOUS êtes assigné, prenez un avocat, ne vous défendez pas vous-même. Je ne le remercierai jamais assez de ce conseil.
Je me suis donc tourné vers le meilleur d’entre nous, ex-æquo verrons-nous plus tard, Maître Mô. Je sais qu’il est trop occupé avec son blog pour encore venir ici donc je profite de son absence pour dire tout le bien que je pense de lui sans froisser sa modestie qui n’a que ses oreilles comme point de comparaison pour son étendue. Maître Mô est un confrère extraordinaire, un avocat compétent et pointu comme j’en ai rarement vu, doté d’un organe qui fait des envieux de Brest à Strasbourg et de Saint-Pierre-et-Miquelon à Nouméa, je parle bien sûr de sa paire de cordes vocales. Et d’organe, il en est un autre qui ne lui fait pas défaut, c’est le cœur, car je n’ai même pas eu besoin de le solliciter qu’il m’avait déjà proposé d’aller botter les fesses de cette association, et que ce serait jusqu’à la victoire ou la mort (fort heureusement, c’est la première qui nous attendait). Il a acquis ma reconnaissance éternelle, quant à mon admiration, il l’avait déjà, elle est juste devenue hors de proportion, comme ses oreilles.
La police ouït également les autres personnes visées par la plainte, et le 27 septembre 2012, je me retrouvai dans le cabinet du juge d’instruction de Nanterre, encadré par mes deux premiers défenseurs, Maître Mô et, comment pourrais-je l’oublier, car je suis sûr que vous, non, Maître Fantômette, une des commensales de ces lieux. J’en profite pour insérer une de ces incises qui font de mon blog ce qu’il est (à savoir mon blog) : non, elle n’écrit plus ici, non, elle n’est pour le moment plus avocate, oui, elle va bien, oui, elle est heureuse. Le reste ne regarde qu’elle.
Une mise en examen pour une affaire d’injure et diffamation n’est qu’une formalité. Le droit de la presse est une matière très particulière, avec énormément de règles dérogatoires et spéciales, vous allez voir. L’une de ces règles est que le juge d’instruction est dépouillé de l’essentiel de ses pouvoirs comme je l’étais de ma robe : son seul rôle est de déterminer qui est l’auteur du texte litigieux. Il lui est rigoureusement interdit de se pencher sur la question de savoir si les délits en cause sont constitués, tout cela relevant exclusivement du débat devant le tribunal. Dès lors qu’il était établi que j’étais bien maître Eolas (ce que je vous confirme encore ce jour), la suite était en principe écrite.
Sauf que.
Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, que l’IPJ s’est pris une claque à chaque stade de la procédure, sans curieusement particulièrement communiquer sur ce point ? La première lui est tombée dessus ce 27 septembre quand la juge d’instruction a refusé de me mettre en examen pour diffamation lié à l’article de slate.fr, en considérant que cet article, qui ne reprenait que des citations de moi publiées sur Twitter sans m’avoir sollicité à ce sujet, m’était totalement étranger, que je ne pouvais en être ni l’auteur ni le complice, et qu’une simple lecture suffisait à s’assurer de l’évidence de cet état de fait. Normalement, cela aurait dû être la fin des poursuites sur ce point. La suite me réservera quelques surprises. J’ajoute pour l’anecdote, et parce qu’en tant que mis en examen, il ne saurait y avoir de foi du palais, que c’est à ce jour la seule fois que j’ai entendu un juge d’instruction dire : « Je vous mets en examen, mais surtout que ça ne vous empêche pas de continuer. »
Le reste des mises en examen avait déjà suivi son petit bonhomme de chemin, et les autres personnes visées avaient déjà été convoquées et mises en examen selon les termes de la plainte, car, je ne le répéterai jamais assez, c’est une obligation légale pesant sur le juge d’instruction. N’oubliez jamais cela quand tel personnage public se vante d’avoir fait mettre en examen Untel pour l’avoir diffamé.
Mais en accord avec mes conseils, nous avons mis en œuvre une stratégie de défense à outrance. Nous avons décidé de soulever tous les moyens possibles : un avocat ne peut avoir de défense à la petite semaine, la réputation de la profession est en cause. Ma mise en examen impliquait que nous avions enfin accès au dossier, et notamment à la plainte qui est à l’origine de tout. Plusieurs problèmes procéduraux nous sont vite apparus, à commencer par le fait que l’IPJ agissait représentée par Xavier Bébin, qui était à l’époque délégué général de l’IPJ, fonction qui avait une particularité amusante qui était de ne pas exister. En effet, les statuts de l’association, que nous nous étions procurés, ne prévoyaient pas de fonction statutaire de délégué général. Ce qui est curieux de prime abord car Xavier Bébin était de loin le membre le plus actif de cette association (de fait, je n’en ai jamais vu un autre, mais je n’ai pas installé de compteur non plus). Gardez ça en tête jusqu’au dernier épisode. D’ailleurs même le conseil de l’association s’y était trompé et l’avait par erreur qualifié de secrétaire général dans la plainte.
Seul son président, qui à l’époque était une présidente, pouvait représenter l’association. Elle pouvait déléguer ses pouvoirs, à condition que cette délégation soit antérieure à la plainte, et pour s’en assurer, il fallait que cette délégation fût produite. Or, oups, elle ne l’était pas et s’il devait s’avérer qu’au jour de la plainte, ce délégué général n’avait pas une telle délégation, la plainte était nulle. Donc notre première contre-attaque consista en une requête en nullité de la plainte pour défaut de qualité à agir, et d’autre part pour défaut d’articulation de la plainte, dont la rédaction était franchement bancale, et de défaut d’articulation du réquisitoire du procureur de la République, qui, lui ne l’était pas du tout. Pas bancal, articulé. Le réquisitoire, pas le procureur. Suivez, un peu.
Le droit de la presse est un droit terriblement formaliste, et les formes y sont rigoureusement sanctionnées, bien plus qu’ailleurs en procédure pénale. C’est une matière redoutable. Et une des exigences de ce droit est que la plainte articule les faits et les qualifie, c’est à dire précise quel extrait de texte est attaqué et de quel délit il s’agit. Spécificité du droit de la presse : cette articulation fige irrévocablement le procès jusqu’à son terme, aucune requalification n’est possible, alors qu’en droit commun, la cour de cassation répète régulièrement qu’il est du devoir du juge de rendre aux faits leur exacte qualification. Ici, nenni. Il faut que d’emblée, on sache, et surtout que la défense sache de quoi il s’agit. Et le parquet de Nanterre avait rendu le réquisitoire introductif suivant, que je vous cite in extenso :
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre,
Vu la plainte avec constitution de partie civile de l’Institut pour la justice représenté par Monsieur Xavier BEBIN, en date du 31 janvier 2012, et déposée le 2 février 2012 du chef de :
- diffamation publique et injure publique envers un particulier
Faits prévus et punis par les articles 29 al 1 et 2, 32 ail, 33 al 2 et 42 et suivants de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Vu les articles 80, 85 et 86 du code de procédure pénale,
Requiert qu’il plaise à Madame ou Monsieur le juge d’instruction désigné bien vouloir
informer contre toute personne que l’instruction fera connaître.
Cachet, signature.
C’est à peu près aussi articulé que le tronc d’un chêne.
Je vois déjà les magistrats parmi les quelques lecteurs qu’il me reste vu l’abandon criminel dans lequel j’ai trop longtemps laissé ce blog bondir sur leurs claviers. Qu’ils m’excusent de les interrompre : je sais qu’en matière de presse, les réquisitoires introductifs, ces actes, qui, pour laconiques qu’ils soient n’en sont pas moins la pierre angulaire de l’instruction, sont rarement plus développés, mais je m’insurge, et mes défenseurs avec moi, à moins que ce ne soit le contraire : autant je puis admettre que sur une plainte pour seule diffamation ou seule injure, on puisse se contenter de cela, l’élément essentiel étant la plainte, et aucune ambiguité n’étant possible vu l’unicité du fait soulevé dans la plainte, autant, quand deux infractions sont visées, il me paraît nécessaire d’articuler un minimum pour que l’on puisse savoir qui est quoi.
Et si vous n’êtes point d’accord, réjouissez-vous, la chambre de l’instruction de Versailles, le 29 mars 2013, vous a donné raison.
Sur la délégation de pouvoir, le parquet général, dans ses réquisitions, nous donnait raison, mais la veille des débats, l’IPJ a produit le scan d’un papier gribouillé à la main par lequel Axelle Theillier, la présidente de l’IPJ, donnait au délégué général tout pouvoir pour agir en justice. Cela a satisfait la cour, que j’ai connue plus sourcilleuse. Sur l’articulation de la plainte, la cour a estimé souverainement que la plainte articulait et qualifiait les propos qu’elle critiquait. On se demande donc pourquoi la juge d’instruction s’est crue tenue de devoir la réécrire plutôt que la recopier. Sur le réquisitoire, la cour estimait que peu importait que le réquisitoire n’articulât rien puisque seule la plainte comptait vraiment, invoquant un arrêt du 23 janvier 1996. Nous toussâmes fort puisque dans l’arrêt invoqué, le parquet avait trop articulé, ajoutant des faits nouveaux à la plainte initiale: la cour disait que cet ajout était nul en vertu du principe rappelé ci-dessus, que la plainte fixait irrévocablement le cadre du débat, mais ajoutait que cette nullité n’entachait pas les faits visés dans la plainte initiale qui, elle, restait valable et fondait les poursuites sur les faits qu’elle articulait. Ici nous étions dans l’hypothèse inverse où le parquet, loin d’ajouter quoi que ce soit, n’apportait rien faute d’articuler quoi que ce soit.
Quand on n’est pas d’accord avec une décision, la seule façon de la contester est d’exercer un recours : ce fut l’occasion de former notre premier pourvoi, et là, vous allez adorer le droit de la presse.
Le délai de pourvoi de droit commun est de cinq jours francs. C’est bref. Mais point assez, s’est dit le législateur dans sa grande sagesse. En matière de presse, il n’est que de trois jours, parce que… parce que ça nous fait plaisir, ne nous remerciez pas. Nous nous pourvûmes (et ce verbe a rarement l’occasion d’être conjugué au passé simple, profitez-en) dans les délais sachant que notre pourvoi serait nul, car l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Rassurez-vous, je vous traduis.
En procédure, un incident est un événement qui perturbe le cours de la procédure sans y mettre fin. C’est un concept issu de la procédure civile, où il est amplement défini et développé, et utilisé par analogie en procédure pénale sans faire l’objet de la même méticulosité dans les textes. Une demande d’expertise psychiatrique est ainsi un incident, qui s’il est admis, impose au tribunal de reporter sa décision pour permettre l’expertise. Une exception est un moyen de défense (dont on excipe, donc) pour paralyser l’action, que ce soit provisoirement ou définitivement. Par exemple, la question préjudicielle, qui impose à une juridiction pénale de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question soit tranchée par le tribunal compétent, quand la question porte sur la propriété d’un bien immobilier ou sur la nationalité du prévenu. La prescription est une exception définitive qui si elle est accueillie, c’est à dire jugée comme bien fondée, met fin définitivement à l’action sans qu’elle soit jugée au fond. J’en profite pour ajouter qu’une demande visant à faire constater la nullité de procès verbaux de la procédure est une exception, pas un incident, l’article 385 du code de procédure pénale le dit expressément, donc les procureurs qui demandent au tribunal de « joindre l’incident au fond » se plantent, entrainant le tribunal dans leur erreur : c’est l’exception qui doit être jointe au fond, et non l’incident. Pardon, il fallait que ça sorte.
Ici, nous avions soulevé la nullité de la plainte, qui était une exception visant à mettre fin à l’instance. Donc notre pourvoi était nul par application de l’article 59. Ce qui fut d’ailleurs constaté par une ordonnance du président de la chambre criminelle de la cour de cassation le 17 juin 2013, oui, j’ai un autographe de Bertrand Louvel, je l’ai fait encadrer.
Pourquoi avoir fait un pourvoi si nous savions qu’il était nul ? Parce que si nous nous étions abstenus, le jour où une éventuelle décision tranchant le fond en appel d’une façon défavorable pour nous était rendue, l’arrêt du 29 mars 2013 aurait été définitif, le délai de trois jours francs ayant couru. Il fallait pour pouvoir attaquer valablement cet arrêt rejetant notre demande sans mettre fin à l’instance, se pourvoir, se prendre une ordonnance constatant la nullité du pourvoi, attendre que l’affaire soit jugée au fond, et le cas échéant reformer un nouveau pourvoi contre cette décision dans les trois jours la suivant, second pourvoi qui ressuscitera le premier qui du coup ne sera plus nul, car c’est l’ordonnance ayant constaté sa nullité qui sera devenue nulle. Je vous l’avais dit, le droit de la presse, c’est de la magie, c’est mieux que Harry Potter, puisque dans ces livres, personne ne ressuscite jamais. Dans ta face, Dumbledore. Le droit de la presse, c’est Gandalf.
Le 2 septembre 2013, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était rendue, et j’étais pour ma part renvoyé pour diffamation aux côté d’Edouard Boccon-Gibod pour mes propos sur Métro France, et, vous allez rire, à ma grande surprise, sur les propos rapportés par l’article de Julie Brafman, alors que je n’avais pas été mis en examen pour ces faits-là, et renvoyé seul comme un grand pour les divers tweets, réels ou réécrits, dont le fameux #Cacagate. Cette ordonnance était illégale car elle me renvoyait devant le tribunal pour des propos pour lesquels je n’ai pas été mis en examen. Mais on ne peut faire appel d’une ordonnance de renvoi (le parquet le pouvait et ici s’en est abstenu). À ceux qui se demandaient si la justice n’allait pas m’accorder un traitement de faveur, surtout face à une association dont la seule activité semble, à part me faire des procès, critiquer les juges et leur imputer toutes les défaillances de la société, la réponse est non, clairement non ; pour des raisons que je ne m’explique pas encore à ce jour la justice va même avoir les yeux de Chimène pour cette association. Le masochisme des magistrats reste un profond mystère pour moi, et à mon avis la source de nombre de leurs prédicaments chroniques. Bref, cette ordonnance, pour illégale qu’elle fût, ne pouvait être critiquée que devant le tribunal.
Avec cette ordonnance, la phase de l’instruction prenait fin et l’affaire allait être jugée au fond, avec pas moins de quatre prévenus. Un chef de prévention était déjà tombé mais venait de se relever de nulle part tel un pourvoi sur une exception, et la phase judiciaire publique allait avoir lieu.
Mais ceci est une autre histoire. Et un autre billet.
Annexe : Chronologie résumée
- 2 février 2012 : Dépôt de la plainte de l’IPJ. Consignation de 600 euros effectuée le 17 février.
- 14 mars 2012 : Réquisitoire introductif
- 15 mars 2012 : Désignation du juge d’instruction.
- 16 mars 2012 : Commission rogatoire du juge d’instruction
- 19 avril 2012 : Audition de votre serviteur.
- 29 mai 2012 : audition de Julie Brafman.
- 6 juin 2012 : retour de la commission rogatoire.
- 11 septembre 2012 : Mise en examen de Julie Brafman, de Jean-Marie Clombani et d’Edouard Boccon-Gibod.
- 27 septembre 2012 : mise en examen de votre serviteur.
- 26 décembre 2012 : Requête en nullité.
- 1er mars 2013 : Audience devant la chambre de l’instruction.
- 29 mars 2013 : Arrêt de la chambre de l’instruction rejetant la requête en nullité.
- 17 juin 2013 : Ordonnance du président de la chambre criminelle déclarant le pourvoi frappé de nullité.
- 2 septembre 2013 : Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.